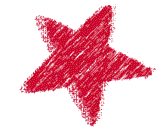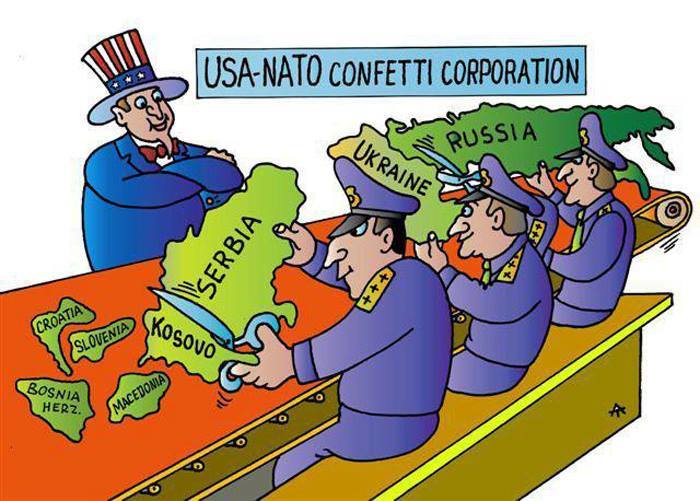Informazione
Il 16 dicembre scorso abbiamo assistito alla presentazione di una raccolta di scritti di Stelio Spadaro, oggi esponente del PD, già segretario locale dei DS, iscritto al PCI dal 1960. Della sua biografia ricordiamo che nel 1953 aveva partecipato ai moti per Trieste italiana (anche un altro esponente del centrosinistra triestino, Claudio Boniciolli oggi dirigente del Porto, aveva vantato in svariate occasioni questa sua militanza filo-italiana), e che fu l’artefice del pellegrinaggio di esponenti del PCI alla foiba di Basovizza nell’agosto del 1989 (dove lui peraltro non era presente). Il nome di Spadaro oggi a Trieste è legato alla sua campagna sulle foibe e sull’esodo istriano. Riferiremo qui i punti salienti delle relazioni, intervallando di tanto in tanto nostri commenti.
Il primo intervento è stato quello del giornalista del “Piccolo” Fulvio Gon, che dopo avere elogiato “l’opera di pacificazione” operata dai sindaci Illy e Di Piazza, ha ripreso quanto il suo collega Pierluigi Sabatti ha scritto nella prefazione al libro, cioè che Spadaro è stato uno degli “inventori” della candidatura di Illy. Ha poi elencato tutta una serie di argomenti sui quali Spadaro ha spaziato, dagli anni 60 in poi, lasciando per ultima la “questione delle foibe”, rimaste per lungo tempo un “tabù che nessuno nominava”, mentre oggi è un problema discusso e capito (discusso d’accordo, ma capito… ndr). Sarebbe stato solo dopo e grazie a questa attività di Spadaro che Illy è diventato sindaco; e Di Piazza è il corrispettivo nel centro destra del tipo di sindaco che è stato Illy per il centrosinistra.
È seguito l’intervento del sindaco Di Piazza, che dopo avere affermato di essere arrivato alla carica di sindaco di Trieste del tutto ignorante in materia di vicende storiche, foibe ed esodo, oggi che sa che a Trieste “dietro ogni angolo di strada c’è un morto di destra o di sinistra” è “padrone della storia della città” (possiamo sollevare dei dubbi su questo? ndr). Ha portato Trieste verso la pacificazione, oggi a Trieste si parla di tutto ma non era così prima che lui fosse sindaco.
Oggi a Trieste ci sono il monumento della Risiera e quello delle foibe “per la parte opposta: così ciascuno ha il suo monumento” (della serie “la lottizzazione della memoria storica”? ndr).
Ha poi infilato una delle sue tipiche topiche (scusate il bisticcio) dicendo che “bisogna avere anche fortuna nella vita” e che il suo “successo come sindaco” nell’opera di pacificazione è dovuto anche a delle “fortune”, come l’erezione del monumento a Norma Cossetto, successivo alla medaglia a lei insignita ed all’intitolazione della via a don Bonifacio, dopo la sua canonizzazione.
Per spiegare come sia cambiata la situazione in città ha ricordato l’occasione in cui è stato contestato in Risiera quando voleva “fare un discorso pirotecnico” (sic), tanto pirotecnico, aggiungiamo, che invece di dire “onore ai martiri della Risiera” ha detto “onore ai martiri delle fo…”, e nonostante si fosse subito corretto (“no, non delle foibe, della Risiera”, della serie pezo el tacòn ch’l buxo) “gente coi lineamenti alterati mi gridava di tutto e di più”, e poi “ho prese pietre così grosse in Risiera”, indicando con le mani un diametro di circa trenta centimetri. Non esageriamo, Sindaco: nessuno le ha tirato pietre in Risiera. Eravamo presenti: se fosse accaduto lo avremmo visto e poi si sarebbe risaputo.
Ma il problema non è di pacificazione o di chiusura da parte del pubblico della Risiera, è se Di Piazza pensa che durante una commemorazione ufficiale confondere i martiri della Risiera con i martiri della foibe (un lapsus freudiano? ndr) possa essere una quisquilia e non un’offesa ai sentimenti di chi si trova lì per ricordare qualcuno.
L’intervento successivo è stato quello di Roberto Cosolini, esponente di punta del PD, con un passato nel PCI (nella FGCI fin dagli anni 70) e poi nei DS, che inquadra l’esperienza politica di Spadaro relativamente al “blocco ideologico” in cui si trovava la città fino a poco tempo fa.
Spadaro si è battuto per il pieno riconoscimento del filone del pensiero democratico degli ideali mazziniani, fu con la sua segreteria che la sede dei DS fu dedicata a Carlo Schiffrer (intellettuale socialista e rappresentante del PSI nel CLN triestino) e che esponenti sindacali della UIL (sindacato che prosegue il filone culturale e politico del Corpo Volontari della Libertà fino allora emarginati dalla sinistra) entrarono per la prima volta nei DS.
Qui ci permettiamo di osservare che, con il dovuto rispetto per il pensiero democratico degli ideali mazziniani, esso non ha nulla a che fare con il pensiero comunista, neanche con quello del PCI in cui Spadaro ha militato per 30 anni fino al suo scioglimento. Dato che c’era un Partito repubblicano a disposizione di chi professava ideali mazziniani, perché Spadaro è entrato invece nel PCI? Quanto alla “emarginazione” del sindacato UIL da parte della sinistra, apriamo una parentesi sulla genesi di questo sindacato, così come descritta in un convegno svoltosi a Trieste il 15/10/04. Il segretario della UIL Luca Visintini affermò che il sindacato UIL era il legittimo erede di quei Sindacati giuliani nati dal CLN triestino, costituiti in alternativa ai Sindacati unici, i quali avevano un atteggiamento anticapitalistico e quindi estraneo alla Camera del Lavoro che negoziava i diritti; inoltre i Sindacati unici indicevano scioperi per Trieste jugoslava e quindi facevano politica e non sindacato. Come esempio di coerenza, Visintini ha però rivendicato che la UIL, quando iniziarono le manifestazioni per Trieste italiana nel 1952, diede, indicendo uno sciopero generale, la copertura ad una manifestazione nella quale ci fu un morto, e addirittura indisse quella del 1953, quando i morti furono diversi. Visintini aggiunse che nel dopoguerra il sindacato iscrisse ex fascisti in funzione antijugoslava, e che verso la comunità slovena vi fu da parte della UIL una chiusura non etnica ma politica (!?!). Ancora più espliciti Antonio Di Turo (i sindacati giuliani furono fondati “per impedire ai comunisti slavi l’annessione di Trieste alla Jugoslavia”) e Oliviero Fragiacomo (“il sindacato giuliano ha salvato Trieste dalle grinfie di Tito”). Ricordiamo infine che lo storico segretario della UIL triestina Carlo Fabricci risulta nell’elenco degli affiliati alla Loggia P2.
Torniamo all’intervento di Cosolini, che ha ricordato quando nell’agosto del 1989 una delegazione del PCI si recò all’isola di Arbe (dove furono detenuti dal fascismo in condizioni inumane centinaia di prigionieri civili, vecchi, donne e bambini), alla Risiera di San Sabba ed alla foiba di Basovizza, sottolineando che ciò fu fatto prima della caduta del muro di Berlino. Noi osserviamo che difficilmente i vertici del PCI ignoravano cosa stesse accadendo in quel periodo nei paesi dell’Est europeo (molti dirigenti di vari partiti andarono in quel periodo in missione in quei Paesi) quindi questo pellegrinaggio può essere interpretato anche come un segno del mutamento della politica del PCI in previsione del capovolgimento politico che si stava preparando.
Cosolini ha concluso sostenendo che la progettualità politica di creare una continuità di governo tra centro sinistra e centro destra ha avuto come prosecuzione naturale di Illy l’elezione di Di Piazza; questa continuità ha portato alla pacificazione della città dove sono rimaste solo alcune frange estreme di “giapponesi” (definizione orribile, ma tant’è) che non vogliono rendersi conto che le cose sono cambiate, questo sia a destra dove molti ancora non vengono in Risiera, sia a sinistra dove si parla ancora di “territorio etnico” o di “partito etnico” per gli sloveni (come se gli sloveni fossero tutti di sinistra o la sinistra fosse tutta slovena? ndr).
Vediamo ora l’intervento del protagonista della serata, Stelio Spadaro, che si è autodefinito “fautore del patriottismo democratico” ed ha ricordato come a Trieste la sinistra, tranne durante l’epoca di Vidali, non ha mai detto niente sulla questione dell’esodo (considerando che Vittorio Vidali è ritornato a Trieste nel 1947 e vi è morto nel 1986, sarebbe interessante sapere cosa intenda Spadaro per “epoca” di Vidali, che del resto fu un accanito sostenitore della politica sovietica in opposizione a quella jugoslava, quindi le sue posizioni sull’esodo istriano potevano essere determinate da ciò).
Spadaro ha poi citato tre momenti storici di pregnanza per la vita politica triestina. Il primo è la fine di aprile del 1945, quando “tutti erano nazisti” (?) e “sloveni e croati consideravano la regione come un territorio etnicamente loro”, cosa che “dicono ancora oggi”, e il concetto di “fratellanza” per loro era solo “uno strumento per entrare più facilmente nel territorio triestino” (potremmo scrivere pagine intere sulla falsità intrisa di razzismo contenuta in queste poche parole, ma sorvoliamo per motivi di spazio, ndr), mentre in quel momento il CLN di don Marzari diede “un segnale di dignità e di discontinuità con il passato”.
Poi Spadaro ha detto che secondo Dario Groppi (membro democristiano del CLN) il dirigente comunista Luigi Frausin avrebbe insistito per fare anche a Trieste un CLN come in Italia, e qui apriamo un’altra parentesi, perché viene detto ad ogni piè sospinto che Frausin sarebbe stato arrestato in seguito ad una delazione operata da non meglio precisati “partigiani slavi” che avrebbero tradito Frausin perché si era posto in contrapposizione alle “mire jugoslave su Trieste” (vi rinviamo all’articolo “Il caso Frausin” nel nostro sito). Nell’estate del ‘44 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI, ) ebbe degli incontri a Milano con rappresentanti dell’Osvoboldilna Fronta (OF), nel corso dei quali si accordarono per un’alleanza antinazifascista. Il CLN triestino rifiutò questa alleanza in quanto non voleva “collaborare con gli slavi”, e per rispettare le direttive del CLNAI il PCI triestino uscì dal CLN. In questo contesto dalle parole di Groppi si evince che Frausin voleva che il CLN triestino si adeguasse alle decisioni del CLNAI, quindi che accettasse di collaborare “con gli slavi”.
Secondo momento storico il 1976, quando l’opposizione al trattato di Osimo diede vita ad un grosso movimento che portò alla creazione della Lista per Trieste (poi degenerato), e Vidali fu accolto con “molto sollievo” nell’assemblea della Lista. Per chi non ha vissuto quel periodo dobbiamo spiegare che a Trieste nacque un grosso movimento di protesta in seguito alla firma, ad Osimo, del definitivo accordo sui confini tra Italia e Jugoslavia, con conseguente decisione che la ex “zona A” (la provincia di Trieste, per semplificare) sarebbe rimasta definitivamente all’Italia, mentre la ex “zona B” (il capodistriano, sempre per semplificare) sarebbe rimasta alla Jugoslavia; dal 1954 Italia e Jugoslavia amministravano i due territori, che avrebbero dovuto costituire il Territorio Libero di Trieste, mai realizzato. In realtà l’opposizione cosiddetta “ad Osimo” non era compattamente contraria alla soluzione definitiva dei confini, ma gran parte della città si ribellò invece (chi per motivi ambientali, chi per motivi politico-economici, chi per nazionalismo) alla prevista realizzazione di una “zona franca industriale”, che avrebbe dovuto sorgere sul Carso triestino a cavallo del confine italo-jugoslavo. Questa zona industriale (che dal punto di vista ambientale sarebbe stata un disastro) fortunatamente non fu mai realizzata, ma nel frattempo l’opposizione ad Osimo si raggruppò nella Lista per Trieste, una lista civica ante litteram, che dopo alcuni anni fu monopolizzata da una destra nazionalista fino a convergere in Forza Italia.
Dopo questo tuffo nel passato torniamo al discorso di Spadaro: il terzo periodo sarebbe quello seguito al 1994: la Jugoslavia allora era in fiamme, era un momento di grande instabilità e Illy a Trieste seppe individuare una soluzione di unità cittadina, cominciò un lavoro di pacificazione iniziando a salutare in sloveno, in modo che le idee diverse tra destra e sinistra venissero unificate nel rispetto reciproco. Qui si inserisce in modo significativo la presenza di Fini e Violante a Trieste (1997) perché era necessario portare le vicende giuliane a conoscenza nazionale. In questo modo i due sindaci hanno unificato la città e messo ai margini i “giapponesi”.
In conclusione Spadaro ha sostenuto che l’integrazione è nel DNA di Trieste, per essa non è possibile nessuna forma di indipendentismo, lui è nemico di tutti i localismi che isolano Trieste dal paese. Illy fu un grande sindaco perché fece conoscere Trieste nel mondo; l’unica critica che gli muove è che con la legge di tutela fece una “regressione culturale e politica”. Parole queste ultime tanto inaccettabili che si commentano da sole.
In sintesi possiamo dire che questo incontro ci è stato basilare perché ha confermato quanto già sospettavamo da anni: c’è stata un’operazione politica trasversale tra partiti di destra e di sinistra (operazione della quale si è fatto rappresentante palese Stelio Spadaro: ma sarebbe bello conoscere anche i nomi degli organizzatori dietro le quinte, per i quali abbiamo solo sospetti), che attraverso una riscrittura della storia (parificazione tra “totalitarismi” e criminalizzazione della Resistenza non nazionalista) ha operato in modo da giungere ad una coesione per la gestione della cosa pubblica, una sorta di “grande centro” che lascia ai lati gli “estremisti” (i giapponesi) di destra e di sinistra, cioè di coloro che ancora tengono conto (nel bene o nel male) di certi valori ideologici. Questa operazione ha dato i frutti che vediamo ogni giorno: trionfo del qualunquismo, elogio della zona grigia, rifiuto della “politica”, vista come un valore negativo (in questo si distinguono i seguaci di Beppe Grillo, che oltre a buttare – scusate l’espressione – merda su tutti e tutto discorsi politici non ne fanno) e trasformazione “aziendale” e privatizzazione degli enti pubblici, con conseguente diminuzione di servizi al cittadino.
In questo clima di presunta “pacificazione” possiamo inserire la questione della “Civica benemerenza” (un riconoscimento che il Comune di Trieste conferisce a cittadini che “abbiano acquisito significative benemerenze in campi culturali, scientifici, umanitari o per altre importanti motivazioni di particolare valenza per la città”, che lo scrittore triestino di lingua slovena Boris Pahor (candidato al Nobel e tradotto in varie lingue, ultima di tutte l’italiano… dato che nessuno è profeta in patria) ha dichiarato di non volere accettare. La motivazione dell’onorificenza “per le sofferenze subite durante il nazismo” è stata infatti rifiutata dallo scrittore: “il nazismo, certo, mi perseguitò duramente; tuttavia, le prime sofferenze mi furono inflitte dal fascismo, che mi rubò l’adolescenza e l’identità (…) avrei voluto che si aggiungesse una parola in più. Quella parola”. E ancora “se il Comune di Trieste non può inserire la parola fascismo nelle motivazioni del riconoscimento, allora non me lo dia. Non piangerò per questo. Peraltro non ho mai chiesto nulla”.
Pahor, novantasei anni compiuti, nel 1920 (a sette anni) vide i fascisti bruciare la Casa della Cultura slovena, prima ancora che il fascismo andasse al potere; il fascismo gli impedì di parlare, leggere, studiare nella propria lingua madre; il fascismo infine, alleato di Hitler, fu complice nella sua deportazione in un campo di concentramento nazista. Alle parole dello scrittore il sindaco Di Piazza che si ritiene “padrone della storia della città” ha risposto: “dobbiamo guardare avanti, lasciamo la storia agli storici”. Come se non fosse stato proprio il Comune a parlare di storia offrendo l’onorificenza a Pahor in quei termini, i termini di una storia monca, parziale, quella che vuole escludere le responsabilità del fascismo nelle tragedie del Ventesimo secolo.
A Boris Pahor verrà invece consegnata da un comitato di intellettuali triestini (tra i quali Claudio Cossu, Margherita Hack e il senatore Fulvio Camerini) una benemerenza intitolata a “Trieste Cultura Civile” con la seguente motivazione: “per il suo impegno antifascista di cultura,di dignità e di coerenza così da farne un simbolo di testimone vivente di resistenza contro il fascismo di ieri e di oggi nel contesto della Trieste vera, multietnica e multiculturale al di fuori delle istituzioni ipocritamente silenti della nostra città”. Un modo di dare vita ad un’altra Trieste, che non è quella “pacificata” da Spadaro, Illy e Di Piazza, ma che rifiuta di essere considerata alla stregua di nostalgici che non si rendono conto che i tempi sono cambiati. Perché anche se i tempi cambiano (e non è detto che il cambiamento sia in senso positivo) non si vede il motivo di gettare al macero valori civili come l’antifascismo e la fedeltà alla Costituzione.
Gennaio 2010
BUDAPEST/BERLIN (Eigener Bericht) - Wenige Monate vor den Parlamentswahlen in Ungarn, einem der engsten Partnerstaaten Deutschlands in Europa, warnen Beobachter vor einer Radikalisierung der dortigen Politik. Der mutmaßliche künftige Ministerpräsident Viktor Orbán (Fidesz-Partei) deutet an, dem deutschen Vorbild folgen und ungarischsprachigen Bürgern der Nachbarstaaten die ungarische Staatsbürgerschaft verleihen zu wollen. Ungarn würde damit bis zu 2,5 Millionen Menschen vereinnahmen. Die völkischen Pläne stoßen schon jetzt auf Widerstand. Im Inland reißt die Radikalisierung, die aus Orbáns Fidesz-Partei heraus betrieben wird, tiefe Gräben auf. Völkischer Antisemitismus und Gewalt gegen Roma nehmen dramatisch zu; der Mythos vom "jüdischen Bolschewismus" "ist in Ungarn lebendiger denn je" und wird auf die jetzige sozialistische Regierung angewandt, berichtet die Kulturwissenschaftlerin Magdalena Marsovszky im Gespräch mit dieser Redaktion. Beobachter sagen Ungarn nach Orbáns als sicher geltendem Wahlsieg im April "lange Jahre einer autoritären Herrschaft" voraus. Orbán und seine Fidesz-Partei arbeiten eng mit Vorfeldorganisationen der deutschen Außenpolitik und mit deutschen Parteien zusammen. Die extrem rechte Partei Jobbik, mit welcher Fidesz gelegentlich kooperiert, feiert inzwischen öffentlich das Staatsoberhaupt der Zwischenkriegszeit, Miklós Horthy - einen Parteigänger NS-Deutschlands.
mehr: http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57706
"Lebensraum Karpatenbecken"
BUDAPEST Über das Erstarken der völkischen Rechten in Ungarn sprach german-foreign-policy.com mit Magdalena Marsovszky. Marsovszky ist Kulturwissenschaftlerin, Mitarbeiterin im Zentrum für Demokratie- und Extremismusforschung im Institut für Politikwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften sowie im Villigster Forschungsforum zu Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus e.V. (www.forschungsforum.net) und untersucht seit Jahren den völkischen Rechtsschub in Ungarn.
mehr: http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57705 )
Hitler, il modello dei “democratici” governanti della Georgia?
Da qualche tempo il canale televisivo “Sakartvelo” (“Georgia” in georgiano) trasmette uno spot pubblicitario, in cui i giovani della repubblica caucasica vengono invitati ad arruolarsi nell’esercito.
Nulla di speciale. I soliti giovani sorridenti che varcano le soglie di una caserma, le stesse immagini che possiamo vedere in ogni spazio di propaganda televisiva per le forze armate di qualsiasi paese del mondo.
Peccato che queste immagini siano accompagnate da una frase che appare sullo schermo e che la dice lunga sulle caratteristiche “democratiche” di un regime, arrivato al potere con una “rivoluzione colorata” e benedetto da tutte le potenze dell’Occidente, che si apprestano ad accoglierlo nella NATO, tra i “combattenti della libertà”: “Dobbiamo comprendere una volta per tutte che non recupereremo mai i territori perduti, né con discorsi trasformati in formalismi, né riponendo speranze nella Lega delle Nazioni. Solo con la forza delle armi. Adolf Hitler. 1932”. Il tutto condito da un commento di un attore che pronuncia, con particolare enfasi, le ultime parole di questa dichiarazione del führer.
Il gravissimo comportamento della televisione georgiana è stato denunciato dalle organizzazioni dei diritti umani presenti a Tbilisi, senza peraltro suscitare alcuna reazione nei media dei paesi alleati del governo di Saakashvili.
L’episodio, sintomatico della deriva di chiaro stampo fascista del regime georgiano (che continua nella sua politica di repressione di ogni forma di dissenso), è avvenuto in coincidenza con la decisione del governo di abbattere il sacrario dedicato ai caduti della Seconda Guerra Mondiale e in aperta violazione degli impegni, assunti a livello internazionale, a ricercare una soluzione pacifica della questione dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, dopo la catastrofica sconfitta subita nel 2008 nella breve guerra con la Russia, scoppiata in seguito al tentativo georgiano di stroncare con la forza le aspirazioni indipendentiste di queste due regioni caucasiche.
6/01/2010
http://www.lernesto.it/index.aspx?m=77&f=2&IDArticolo=18693
La technique du coup d’État coloré
par John Laughland*
La technique des coups d’État colorés trouve son origine dans une abondante littérature du début du XXe siècle. Elle a été mise en application avec succès par les néo-conservateurs états-uniens pour « changer les régimes » de plusieurs États post-soviétiques. Elle a par contre échoué dans des univers culturels différents (Venezuela, Liban, Iran). John Laughland, qui couvrit certaines de ces opérations pour le Guardian, revient sur ce phénomène.
Au cours de ces dernières années, une série de « révolutions » ont éclaté en différents endroits du monde.
Georgie
En novembre 2003, le président Edouard Chevardnadze a été renversé à la suite de manifestations et d’allégations d’élections truquées.
Ukraine
En novembre 2004, des manifestations – la « Révolution orange » – commencèrent au moment où des accusations similaires d’élections truquées étaient formulées. Il en résulta que le pays perdit son ancien rôle géopolitique de pont entre l’Est et l’Ouest et fut poussé vers une adhésion à l’OTAN et à l’UE. Étant donné que la Rus de Kiev fut le premier État russe et que l’Ukraine s’est maintenant tournée contre la Russie, il s’agit là d’un événement historique. Mais, comme le disait George Bush, « vous êtes soit avec nous soit contre nous ». Bien que l’Ukraine ait envoyé des troupes en Irak, elle était manifestement considérée comme trop amie de Moscou.
Liban
Peu après que les États-Unis et l’ONU aient déclaré que les troupes syriennes devaient se retirer du Liban et suite à l’assassinat de Rafik Hariri, les manifestations de Beyrouth ont été présentées comme la « Révolution du Cèdre ». Une énorme contre-manifestation du Hezbollah, le plus important parti pro-syrien, fut passée sous silence alors que la télévision montrait sans fin la foule anti-syrienne. Exemple particulièrement énorme de mauvaise foi orwellienne, la BBC expliqua aux téléspectateurs que « le Hezbollah, le plus grand parti politique du Liban, est jusqu’ici la seule voix dissidente qui souhaite que les Syriens restent au Liban ». Comment la majorité populaire peut-elle être une « voix dissidente » ? [1]
Kirghizistan
Après les « révolutions géorgienne et ukrainienne, nombreux sont ceux qui prédisaient que la vague de « révolutions » allait s’étendre aux anciens États soviétiques d’Asie centrale. Et c’est ce qui arriva. Les commentateurs semblaient divisés sur la question de savoir quelle couleur attribuer au soulèvement de Bichkek : révolution « citron » ou « tulipe » ? Ils n’ont pas pu se décider. Mais ils étaient tous d’accord sur un point : ces révolutions sont cool, même quand elles sont violentes. Le président du pays, Askar Akaïev, fut renversé le 24 mars 2005 et les contestataires prirent d’assaut le palais présidentiel et le mirent à sac.
Ouzbékistan
Lorsque des rebelles armés s’emparèrent des bâtiments gouvernementaux, libérèrent des prisonniers et prirent des otages dans la nuit du 12 au 13 mai dans la ville ouzbek d’Andijan (située dans la vallée de Ferghana où les troubles avaient également commencé au Kirghizistan voisin), la police et l’armée encerclèrent les rebelles et il en résulta une impasse de longue durée. On entreprit des négociations avec les rebelles qui ne cessèrent d’augmenter leurs revendications. Quand les forces gouvernementales les attaquèrent, les combats firent quelque 160 morts dont 30 parmi les forces de la police et de l’armée. Pourtant les médias occidentaux présentèrent immédiatement ces affrontements violents de manière déformée, prétendant que les forces gouvernementales avaient ouvert le feu sur des contestataires non armés, sur « le peuple ».
Ce mythe sans cesse répété de la révolte populaire contre un gouvernement dictatorial est populaire à gauche comme à droite de l’éventail politique. Autrefois, le mythe de la révolution était manifestement réservé à la gauche, mais lorsque le putsch violent eut lieu au Kirghizistan, le Times s’enthousiasma à propos des scènes de Bichkek qui lui rappelaient les films d’Eisenstein sur la révolution bolchévique ; le Daily Telegraph exalta le « pouvoir pris par le peuple » et le Financial Times eut recours à une métaphore maoïste bien connue lorsqu’il vanta la « longue marche du Kirghizistan vers la liberté ».
Une des idées clés à la base de ce mythe est manifestement que le « peuple » est derrière les événements et que ces derniers sont spontanés. En réalité, bien sûr, ce sont des opérations très organisées, souvent mises en scène pour les médias et habituellement créés et contrôlés par les réseaux transnationaux d’« ONG » qui sont des instruments du pouvoir occidental.
La littérature sur les coups d’État
Le mythe de la révolution populaire spontanée perd de sa prégnance en raison de l’ample littérature sur les coups d’État et les principales tactiques utilisées pour les provoquer. C’est bien entendu Lénine qui a développé la structure organisationnelle vouée au renversement d’un régime que nous connaissons maintenant sous le nom de parti politique. Il différait de Marx en ce qu’il ne pensait pas que le changement historique était le résultat de forces anonymes inéluctables. Il pensait qu’il fallait le provoquer.
Mais ce fut probablement Curzio Malaparte qui le premier, dansTechnique du coup d’État, donna une forme célèbre à ces idées [2]. Publié en 1931, ce livre présente le changement de régime comme une technique. Malaparte était en désaccord avec ceux qui pensaient que les changements de régime étaient spontanés. Il commence son livre en rapportant une discussion entre des diplomates à Varsovie au printemps 1920 : La Pologne a été envahie par l’armée rouge de Trotski (la Pologne avait elle-même envahi l’Union soviétique, prenant Kiev en avril 1920) et les bolcheviques étaient aux portes de Varsovie. La discussion avait lieu entre le ministre de Grande-Bretagne, Sir Horace Rumbold, le Nonce papal, Monseigneur Ambrogio Damiano Achille Ratti (lequel fut élu pape deux ans plus tard sous le nom de Pie XI). L’Anglais disait que la situation politique intérieure de la Pologne était si chaotique qu’une révolution était inévitable et que le corps diplomatique devait fuir la capitale et se rendre à Poznan. Le Nonce n’était pas d’accord, insistant sur le fait qu’une révolution était tout aussi possible dans un pays civilisé comme l’Angleterre, la Hollande ou la Suisse que dans un pays en état d’anarchie. Naturellement, l’Anglais était choqué à l’idée qu’une révolution pût éclater en Angleterre. « Jamais ! » s’exclama-t-il. Les faits lui ont donné tort car il n’y eut aucune révolution en Pologne et cela, selon Malaparte parce que les forces révolutionnaires n’étaient pas suffisamment bien organisées.
Cette anecdote permet à Malaparte d’aborder les différences entre Lénine et Trotski, deux praticiens du coup d’État. Il montre que le futur pape avait raison et qu’il était faux de dire que certaines conditions sont nécessaires pour qu’il y ait révolution. Pour Malaparte, comme pour Trotski, on peut provoquer un changement de régime dans n’importe quel pays, y compris dans les démocraties stables d’Europe occidentale à condition qu’il y ait un groupe d’hommes suffisamment déterminés à l’effectuer.
Fabriquer le consentement
Cela nous amène à d’autres textes relatifs à la manipulation médiatique. Malaparte luimême n’aborde pas cet aspect mais celui-ci est a) très important et b) constitue un élément de la technique utilisée pour les changements de régime aujourd’hui. À vrai dire, le contrôle des médias durant un changement de régime est si important qu’une des caractéristiques de ces révolutions est la création d’une réalité virtuelle. Le contrôle de cette réalité est lui-même un instrument du pouvoir, si bien que lors des coups d’États classiques des républiques bananières, la première chose dont s’emparent les révolutionnaires est la radio.
Les gens éprouvent une forte répugnance à accepter l’idée que les événements politiques, aujourd’hui, sont délibérément manipulés. Cette répugnance est elle-même un produit de l’idéologie de l’ère de l’information qui flatte la vanité des gens et les incite à croire qu’ils ont accès à une somme considérable d’informations. En fait, l’apparente diversité de l’information médiatique moderne cache une extrême pauvreté de sources originales, de même qu’une rue entière de restaurants sur un rivage grec peut cacher la réalité d’une seule cuisine à l’arrière. Les informations sur les événements importants proviennent souvent d’une source unique, souvent une agence de presse et même des diffuseurs d’informations comme la BBC se contentent de recycler les informations reçues de ces agences tout en les présentant comme étant les leurs. Les correspondants de la BBC sont souvent dans leurs chambres d’hôtel lorsqu’ils envoient leurs dépêches, lisant souvent pour le studio de Londres l’information que leur ont transmise leur collègues en Angleterre, qui les ont à leur tour reçues des agences de presse. Un second facteur expliquant la répugnance à croire à la manipulation des médias est lié au sentiment d’omniscience que notre époque de mass média aime flatter : critiquer les informations de la presse, c’est dire aux gens qu’ils sont crédules et ce message n’est pas agréable à recevoir.
La manipulation médiatique a plusieurs aspects. L’un des plus importants est l’iconographie politique. C’est un instrument très important utilisé pour défendre la légitimité des régimes qui ont pris le pouvoir par la révolution. Il suffit de penser à des événements emblématiques comme la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, l’assaut du Palais d’Hiver pendant la révolution d’octobre 1917 ou la marche de Mussolini sur Rome en 1922 pour se rendre compte que certains événements peuvent être élevés au rang de sources presque éternelles de légitimité.
Cependant, l’importance de l’imagerie politique va bien au-delà de l’invention d’un emblème pour chaque révolution. Elle implique un contrôle beaucoup plus rigoureux des médias et généralement ce contrôle doit être exercé sur une longue période, pas seulement au moment du changement de régime. Il est vraiment essentiel que la ligne du parti soit répétée ad nauseam. Un aspect de la culture médiatique d’aujourd’hui que de nombreux dissidents dénoncent à la légère est que les opinions dissidentes peuvent être exprimées et publiées, mais c’est précisément parce que, n’étant que des gouttes d’eau dans l’océan, elles ne représentent jamais une menace pour la marée propagandiste.
Willy Münzenberg
Un des maîtres modernes du contrôle des médias fut le communiste allemand avec qui Goebbels apprit son métier, Willy Münzenberg. Il n’est pas seulement l’inventeur de la manipulation mais aussi le premier à avoir mis au point l’art de créer un réseau de journalistes formateurs de l’opinion qui propagèrent des idées correspondant aux besoins du Parti communiste allemand et à l’Union soviétique. Il fit fortune en édifiant un vaste empire médiatique.
Il était très impliqué dans le projet communiste dès le début. Il appartenait aux proches de Lénine à Zurich et en 1917, il accompagna le futur chef de la révolution bolchévique de la gare centrale de Zurich à la gare de Finlande à Saint-Pétersbourg dans un train plombé, avec l’aide des autorités impériales allemandes. Lénine demanda à Münzenberg de combattre la publicité épouvantable suscitée par le fait qu’en 1921, 25 millions de paysans de la région de la Volga commencèrent à souffrir de la famine qui frappait l’État soviétique nouvellement créé. Münzenberg, qui était alors rentré à Berlin où il fut plus tard élu député communiste au Reichstag, fut chargé de créer une œuvre de bienfaisance ouvrière factice, le Foreign Committee for the Organisation of Worker Relief for the Hungry in Soviet Russia dont le but était de faire croire que les secours humanitaires provenaient d’autres sources que de la Herbert Hoover’s American Relief Administration. Lénine craignait non seulement que Hoover utilise son projet humanitaire pour envoyer des espions en URSS (ce qu’il fit) mais également – chose peut-être plus importante – que le premier État communiste au monde ne souffre fatalement de la publicité négative due au fait que l’Amérique capitaliste lui venait en aide à quelques années de la Révolution.
Après s’être fait la main en « vendant » la mort de millions de personnes causée par les bolcheviques, Münzenberg se tourna vers des activités de propagande plus générales. Il édifia un vaste empire médiatique connu sous le nom de Trust Münzenberg qui possédait deux quotidiens de masse en Allemagne, un hebdomadaire de masse et avait des intérêts dans d’autres publications dans le monde. Il s’illustra particulièrement en mobilisant l’opinion mondiale contre l’Amérique lors du procès de Sacco et Vanzetti (deux immigrés italiens anarchistes condamnés à mort pour meurtre dans le Massachusetts en 1921) et pour contrebalancer l’idée propagée par les nazis selon laquelle l’incendie du Reichstag en 1933, était l’œuvre d’un complot communiste. Rappelons que les nazis prirent prétexte de cet incendie pour procéder à des arrestations et à des exécutions en masse de communistes. (On pense maintenant que le feu a en réalité été mis à titre individuel par l’homme qui fut arrêté dans le bâtiment à l’époque, le pyromane Martinus van der Lubbe). Münzenberg réussit à convaincre une partie importante de l’opinion d’un mensonge opposé à celui des nazis, c’est-à-dire que ceux-ci avaient mis le feu eux-mêmes afin d’avoir un prétexte pour se débarrasser de leurs principaux adversaires.
Le fait le plus significatif pour notre époque est que Münzenberg comprit combien il est important d’influencer les faiseurs d’opinion. Il avait essentiellement pour cible les intellectuels, partant de l’idée qu’ils étaient faciles à influencer en raison de leur grande vanité. Il avait notamment des contacts avec un grand nombre de personnalités littéraires des années 1930. Il en encouragea beaucoup à soutenir les Républicains lors de la guerre civile espagnole et d’en faire une cause célèbre de l’anti-fascisme communiste. La tactique de Münzenberg revêt une grande importance dans la manipulation de l’opinion en faveur du Nouvel ordre mondial aujourd’hui. Plus que jamais, des « experts » apparaissent sur nos petits écrans pour nous expliquer les événements et ils sont toujours des véhicules de la ligne officielle du parti. On les contrôle de différentes manières, généralement avec de l’argent ou par la flatterie.
Psychologie de la manipulation de l’opinion
Il existe une série d’ouvrages qui mettent le doigt sur un aspect un peu différent de la technique spécifique mise au point par Münzenberg. Il concerne la manière d’amener les gens à agir collectivement en recourant à des stimuli psychologiques. Peut-être que le premier théoricien important en fut le neveu de Freud, Edward Bernays, qui écrivait dans son ouvrage Propaganda, paru en 1928, qu’il était tout à fait naturel et justifié que les gouvernements façonnent l’opinion publique à des fins politiques [3]. Le premier chapitre porte le titre révélateur suivant : « Organiser le chaos ». Pour Bernays, la manipulation consciente et intelligente des opinions et des habitudes des masses est un élément important des sociétés démocratiques. Ceux qui manipulent les mécanismes cachés de la société constituent un gouvernement invisible qui représente le vrai pouvoir. Nous sommes dirigés, nos esprits sont façonnés, nos goûts formés, nos idées suggérées essentiellement par des hommes dont nous n’avons jamais entendu parler. C’est la conséquence logique de la manière dont notre société démocratique est organisée. Un grand nombre d’êtres humains doivent coopérer afin de vivre ensemble dans une société qui fonctionne bien. Dans presque tous les actes de notre vie quotidienne, qu’il s’agisse de la sphère politique, des affaires, de nos comportements sociaux ou de nos conceptions éthiques, nous sommes dominés par un nombre relativement réduit de personnes qui connaissent les processus mentaux et les caractéristiques sociales des masses. Ce sont elles qui contrôlent l’opinion.
Pour Bernays, très souvent les membres du gouvernement invisible ne savent même pas qui en sont les autres membres. La propagande est le seul moyen d’empêcher l’opinion publique de sombrer dans le chaos. Bernays continua de travailler sur le sujet après la guerre et a publié, en 1947, The Engineering of Consent [4], titre auquel Edward Herman et Noam Chomsky faisaient allusion lorsqu’ils publièrent leur ouvrage majeur La fabrique du consentement en 1988 [5]. Le rapport avec Freud est important parce que, comme nous allons le voir, la psychologie est un outil capital pour influencer l’opinion publique. Selon deux des auteurs ayant collaboré à La fabrique du consentement, Doris E. Fleischmann et Howard Walden Cutler écrivent que chaque chef politique doit faire appel à des émotions humaines de base afin de manipuler l’opinion. L’instinct de conservation, l’ambition, l’orgueil, la faim, l’amour de la famille et des enfants, le patriotisme, l’esprit d’imitation, le désir de commander, le goût du jeu ainsi que d’autres besoins sont les matières brutes psychologiques que chaque leader doit prendre en compte dans ses efforts pour gagner l’opinion publique à ses idées. Pour préserver leur confiance en eux, la plupart des gens ont besoin d’être certains que tout ce qu’ils croient est vrai.
C’est ce que Münzenberg avait bien compris : le besoin fondamental des hommes de croire ce qu’ils veulent croire. Thomas Mann faisait allusion à ce phénomène quand il attribua l’ascension d’Hitler au désir collectif du peuple allemand de croire à un « conte de fées » dissimulant la laide réalité.
À ce sujet, d’autres ouvrages méritant d’être mentionnés concernent moins la propagande électronique moderne que la psychologie des foules. Les classiques, ici, sont Psychologie des foules de Gustave Le Bon (1895) [6], Masse et puissance d’Elias Canetti (1960) [7] et Le viol des foules par la propagande politiquede Serge Tchakhotine (1939) [8]. Tous ces livres font abondamment appel à la psychologie et à l’anthropologie. Il y a également le magnifique ouvrage de l’anthropologue René Girard dont les écrits sur la logique de l’imitation (mimesis) et sur les actions violentes collectives sont d’excellents outils pour comprendre pourquoi l’opinion publique peut si facilement être amenée à soutenir la guerre et d’autres formes de violence politique.
Technique de formation de l’opinion
Après la guerre, un grand nombre des techniques mises au point par le communiste Münzenberg furent adoptées par les États-uniens, comme le montre magnifiquement l’excellent ouvrage de Frances Stonor Saunders Qui mène la danse ? La CIA et la Guerre froide culturelle [9]. Saunders explique de manière extrêmement détaillée comment, au début de la Guerre froide, les États-uniens et les Britanniques commencèrent une importante opération clandestine destinée à financer des intellectuels anti-communistes [10]. L’élément fondamental est qu’ils concentrèrent leur attention sur des personnalités de gauche, surtout des trotskistes qui n’avaient cessé de soutenir l’Union soviétique qu’en 1939 lorsque Staline signa le Pacte de non-agression avec Hitler et qui avaient souvent travaillé auparavant pour Münzenberg. Un grand nombre de ces personnes qui se situaient au point de jonction entre le communisme et la CIA au début de la Guerre froide sont devenus des néo-conservateurs de premier plan, en particulier Irving Kristol, James Burnham, Sidney Hook et Lionel Trilling [11].
Les origines gauchistes, voire trotskistes, du néo-conservatisme sont connues, bien que je continue d’être surpris par de nouveaux détails que je découvre, par exemple que Lionel et Diana Trilling ont été mariés par un rabbin qui considérait Felix Dzerjinski, fondateur de la police secrète bolchévique (ancêtre du KGB) et pendant communiste de Himmler, comme un modèle d’héroïsme. Ces origines gauchistes entretiennent un rapport particulier avec les opérations clandestines évoquées par Saunders car l’objectif de la CIA était précisément d’influencer les opposants de gauche au communisme, c’est-à-dire les trotskistes. L’idée de la CIA était simplement que les anti-communistes de droite n’avaient pas besoin d’être influencés et encore moins d’être payés. Saunders cite Michael Warner lorsqu’elle écrit que pour la CIA, la stratégie consistant à soutenir la gauche anticommuniste allait devenir le fondement théorique des opérations politiques de la CIA contre le communisme pendant les deux décennies suivantes.
La stratégie était décrite dans The Vital Center : The Politics of Freedom d’Arthur Schlesinger (1949) [12], ouvrage qui constitue une des pierres angulaires de ce qui devint plus tard le mouvement néoconservateur. Saunders écrit que l’objectif consistant à soutenir des groupes gauchistes n’était ni de détruire ni de dominer ces groupes mais plutôt de maintenir une discrète proximité et de diriger leur pensée, de leur procurer un moyen de se défouler et, à la limite, de s’opposer à leurs actions au cas où ils deviendraient trop « radicaux ». Les manières dont cette influence de gauche fut ressentie furent nombreuses et variées. Les États-Unis étaient décidés à donner d’eux-mêmes une image progressiste, en contraste avec l’Union soviétique « réactionnaire ». Autrement dit, ils voulaient faire exactement ce que faisaient les Soviétiques. En musique, par exemple, Nicolas Nabokov (le cousin de l’auteur de Lolita) était l’un des principaux agents du Congrès pour la liberté de la Culture. En 1954, la CIA finança un festival de musique à Rome au cours duquel l’amour « autoritaire » de Staline pour des compositeurs comme Rimski-Korsakov et Tchaïkovski fut « contré » par de la musique moderne non orthodoxe inspirée du dodécaphonisme de Schoenberg. Pour Nabokov, promouvoir une musique qui abolissait manifestement les hiérarchies naturelles, c’était délivrer un message politique clair. Un autre progressiste, le peintre Jackson Pollock, ancien communiste, fut également soutenu par la CIA. Ses barbouillages étaient censés représenter l’idéologie américaine de la « liberté » opposée à l’autoritarisme de la peinture du réalisme socialiste. (Cette alliance avec les communistes a précédé la Guerre froide : le fresquiste communiste mexicain Diego Rivera fut parrainé par Abby Aldrich Rockefeller mais leur collaboration prit fin subitement lorsque Rivera refusa de retirer un portrait de Lénine d’une scène de foule peinte sur les murs du Rockefeller Center en 1933.)
Ce mélange entre la culture et la politique fut encouragé explicitement par un organisme de la CIA qui avait un nom très orwellien, le Bureau de stratégie psychologique. En 1956, il parraina une tournée européenne du Metropolitan Opera dont l’objectif politique était d’encourager le multiculturalisme. Son organisateur, Junkie Fleischmann, déclara : « Nous, aux États-Unis, nous sommes un melting-pot et par là nous prouvons que les peuples peuvent s’entendre indépendamment des races, des couleurs de peau ou des confessions. En utilisant le terme de « melting-pot » ou toute autre expression accrocheuse, nous pourrions présenter le Met comme un exemple de la manière dont les Européens immigrés peuvent s’entendre aaux États-Unis et suggérer que, par conséquent, une espèce de fédération européenne est tout à fait possible. »
Soit dit en passant, c’est exactement l’argument utilisé notamment par Ben Wattenberg qui, dans son ouvrage The First Universal Nation, soutient que les États-Unis possèdent un droit particulier à l’hégémonie mondiale parce qu’elle réunit toutes les nations et races de la planète. La même idée a été exprimée par Newt Gingrich et d’autres néoconservateurs.
Parmi les autres sujets mis en avant, certains sont au centre de la pensée néoconservatrice d’aujourd’hui. Le premier d’entre eux est la croyance authentiquement libérale à l’universalisme moral et politique. Elle a été au centre de la philosophie de la politique étrangère de George W. Bush. À de nombreuses occasions, il a déclaré que les valeurs politiques sont les mêmes dans le monde entier et il a utilisé cette affirmation pour justifier l’intervention militaire en faveur de la « démocratie ». Au début des années 1950, Raymond Allen, directeur du PSB (le Bureau de stratégie psychologique fut rapidement désigné uniquement par ses initiales, sans doute afin de cacher son vrai nom) était déjà parvenu à la conclusion suivante :
« Les principes et idéaux contenus dans la Déclaration d’indépendance et la Constitution sont destinés à être exportés et constituent le patrimoine des hommes partout dans le monde. Nous devrions nous adresser aux besoins fondamentaux de l’humanité qui, je crois, sont les mêmes pour l’agriculteur du Texas que pour celui du Pendjab. »
Certes, il serait faux d’attribuer la propagation des idées uniquement à la manipulation clandestine. Elles s’inscrivent dans de vastes courants culturels dont les causes sont multiples. Mais il ne fait pas de doute que la domination de ces idées peut être considérablement facilitée par des opérations clandestines, en particulier parce que les gens des sociétés d’information de masse sont étonnamment influençables. Non seulement, ils croient ce qu’ils lisent dans les journaux mais ils s’imaginent qu’ils sont arrivés aux conclusions par eux-mêmes. Par conséquent, l’astuce pour manipuler l’opinion publique consiste à appliquer ce qui a été théorisé par Bernays, mis en place par Münzenberg et élevé au rang d’un grand art par la CIA. Selon l’agent de la CIA Donald Jameson, en ce qui concerne les attitudes que l’Agence désirait susciter par ses activités, il est évident qu’elle voulait produire des gens qui étaient intimement persuadés que tout ce que faisait le gouvernement était juste.
Autrement dit, ce que la CIA et d’autres agences ont fait pendant cette période fut d’adopter la stratégie que nous associons au marxiste italien Antonio Gramsci qui affirmait que l’« hégémonie culturelle » était essentielle pour la révolution socialiste.
Désinformation
Enfin, il existe une quantité énorme de textes sur la technique de désinformation. J’ai déjà mentionné le fait important, formulé à l’origine par Tchakhotine, que le rôle des journalistes et des médias est fondamental pour s’assurer que la propagande est constante. Il écrit que la propagande ne saurait s’interrompre, formulant ainsi une des règles fondamentales de la désinformation moderne qui est que le message doit être répété très souvent pour passer. Avant tout, Tchakhotine dit que les campagnes de propagande doivent être dirigées de manière centralisée et très organisée, ce qui est devenu la norme à l’ère de la « communication » politique moderne. Les membres travaillistes du Parlement britannique, par exemple, ne peuvent pas parler aux médias sans l’autorisation du Director for Communications du 10, Downing Street.
Sefton Delmer était à la fois un praticien et un théoricien de lablack propaganda (désinformation). Il créa une fausse station de radio qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, diffusait de la Grande-Bretagne vers l’Allemagne et répandit le mythe qu’il y avait de bons Allemands patriotes qui s’opposaient à Hitler. On maintint le mythe qu’il s’agissait en réalité d’une station allemande clandestine et on la fit émettre sur des fréquences proches de celles des stations officielles. Ce genre de « black propaganda » fait maintenant partie de l’arsenal de la « communication » gouvernementale états-unienne. Le New York Times a révélé que le gouvernement faisait des bulletins d’informations favorables à sa politique qui étaient ensuite diffusés sur les chaînes ordinaires et présentés comme s’ils émanaient de ces chaînes.
Il y a de nombreux autres auteurs qui ont écrit sur le sujet et j’ai parlé de certains d’entre eux dans ma chronique All News Is Liesmais peut-être que l’ouvrage qui correspond le mieux au débat actuel est celui de Roger Mucchielli, La Subversion, publié en français en 1971 et qui montre que la désinformation, autrefois tactique auxiliaire pendant la guerre, est devenue une tactique principale [13]. Selon lui, la stratégie s’est développée au point que l’objectif est maintenant de conquérir un pays sans même l’attaquer physiquement, en particulier en recourant à des agents d’influence à l’intérieur. C’est essentiellement l’idée proposée et discutée par Robert Kaplan dans son essai publié dans The Atlantic Monthly en juillet/août 2003 et intitulé « Supremacy by Stealth » [14]. Un des plus sinistres théoriciens du Nouvel ordre mondial et de l’Empire américain, Robert Kaplan, défend explicitement l’utilisation illégale et immorale de la force pour permettre aux États-Unis de contrôler le monde entier. Son essai concerne le recours aux opérations secrètes, à la force des armes, aux coups tordus, à la désinformation, aux influences clandestines, à la formation de l’opinion, voire aux assassinats politiques, tous moyens relevant d’une « éthique païenne » et destinés à assurer la domination US.
Un autre point à souligner à propos de Mucchielli est qu’il fut un des premiers théoriciens du recours à de fausses ONG ou « organisations de façade » pour provoquer un changement politique interne dans un autre pays. Comme Malaparte et Trotski, Mucchielli avait compris que ce n’étaient pas des circonstances « objectives » qui faisaient le succès ou l’échec d’une révolution mais la perception de ces circonstances créée par la désinformation. Il avait également compris que les révolutions historiques, qui se présentaient invariablement comme le produit de mouvements de masse, étaient en réalité l’œuvre d’un tout petit nombre de conspirateurs très bien organisés. Comme Trotski, Mucchielli insistait sur le fait que la majorité silencieuse devait être absolument exclue du mécanisme de changement politique, précisément parce que les coups d’État sont l’œuvre d’un petit nombre de personnes et non de la masse.
L’opinion est le « forum » où l’on pratique la subversion et Mucchielli montre les différentes manières d’utiliser les mass médias pour créer une psychose collective. Selon lui, les facteurs psychologiques sont extrêmement importants à cet égard, particulièrement dans la poursuite de stratégies importantes comme la démoralisation d’une société. L’adversaire doit être amené à perdre confiance dans le bien-fondé de sa cause et tous les efforts doivent être tentés pour le convaincre que son adversaire est invincible.
Rôle des militaires
Avant d’aborder le présent, évoquons encore une question d’ordre historique : le rôle des militaires dans la conduite d’opérations secrètes et dans l’influence exercée sur le changement politique. C’est une chose dont certains analystes contemporains admettent volontiers l’existence aujourd’hui : Kaplan approuve le fait que l’armée états-unienne soit utilisée pour « promouvoir la démocratie ». Il se plaît à indiquer qu’un coup de téléphone d’un général US est souvent un meilleur moyen d’encourager un changement politique dans un pays du Tiers Monde qu’un appel de l’ambassadeur des États-Unis. Il cite un officier des Army Special Operations : « Quel que soit le président du Kenya, c’est le même groupe de gars qui dirige les forces spéciales et les gardes du corps du président. Nous les avons entraînés. C’est ce qu’on appelle l’influence diplomatique. »
L’aspect historique du sujet a été récemment étudié par un universitaire suisse, Daniele Ganser dans son livre Les Armées secrètes de l’OTAN [15]. Il commence par mentionner le fait que, le 3 août 1990, Giulio Andreotti, alors Premier ministre, a admis qu’il avait existé une armée secrète dans son pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale connue sous le nom de Gladio, qu’elle avait été créée par la CIA et le MI6 et qu’elle était coordonnée par une section peu orthodoxe de l’OTAN.
Il confirmait ainsi une des rumeurs les plus persistantes de l’Italie de l’après-guerre. De nombreuses personnes dont des magistrats instructeurs avaient le sentiment que Gladio ne faisait pas seulement partie d’un réseau d’armées secrètes créées par les États-Unis en Europe occidentale pour combattre une éventuelle occupation soviétique, mais également que ces réseaux en étaient venus à influencer le résultat d’élections, allant jusqu’à conclure de sinistres alliances avec des organisations terroristes. L’Italie était une cible particulière parce que le Parti communiste y était très puissant.
À l’origine, cette armée secrète avait été mise sur pied dans le but de se préparer à l’éventualité d’une invasion, mais il semble qu’elle effectua bientôt des opérations secrètes visant à influencer les processus politiques eux-mêmes, en l’absence d’invasion. Il existe de nombreuses preuves que les Étaats-uniens se sont ingérés massivement, en particulier dans les élections italiennes, afin d’empêcher le Parti communiste d’accéder au pouvoir. Des dizaines de milliards de dollars ont été offerts aux chrétiens-démocrates pour cette raison.
Ganser va jusqu’à dire qu’on a la preuve que des cellules Gladio ont organisé des attentats terroristes dans le but de faire accuser les communistes et de pousser la population épouvantée à réclamer des pouvoirs spéciaux pour l’État destinés à les « protéger » du terrorisme. Ganser cite l’homme accusé d’avoir posé une des bombes, Vincenzo Vinciguerra, qui a bien expliqué la nature du réseau dont il était un simple soldat. Cela faisait partie d’une stratégie visant à « déstabiliser afin de stabiliser ».
On s’attaquait à des civils, à des femmes, à des enfants, à des innocents, à des inconnus tout à fait étrangers au jeu politique. La raison en était simple : il s’agissait de contraindre le peuple italien à se tourner vers l’État pour demander une plus grande sécurité. Telle est la logique politique qui présidait à tous les massacres dont les auteurs sont restés impunis parce que l’Etat ne pouvait pas se déclarer coupable de ce qui était arrivé. Il existe un rapport évident avec les théories du complot à propos du 11-Septembre. Ganser présente toute une série de preuves selon lesquelles on a agi là comme Gladio en Italie et ses arguments laissent penser qu’il pourrait y avoir eu une alliance avec des groupes d’extrême gauche comme les Brigades Rouges. Après tout, lorsque Aldo Moro fut enlevé – il fut ensuite assassiné –, il se rendait au Parlement pour y présenter un programme de coalition entre les socialistes et les communistes, ce que les États-Unis étaient précisément déterminés à empêcher.
Les tacticiens de la révolution aujourd’hui
Les ouvrages historiques dont j’ai parlé nous aident à comprendre ce qui se passe aujourd’hui. Mes collègues et moi-même du British Helsinki Human Rights Group avons pu constater que les mêmes techniques sont utilisées aujourd’hui.
Les principales tactiques ont été perfectionnées en Amérique latine dans les années 1970–80. Beaucoup d’agents secrets spécialistes du changement de régime de l’époque Reagan et Bush père ont exercé leur métier sans problèmes dans l’ancien bloc soviétique sous Clinton et Bush fils. Le général Noriega raconte dans ses mémoires que les deux agents de la CIA et du département d’Etat envoyés pour négocier puis pour provoquer sa chute du pouvoir à Panama en 1989 s’appelaient William Walker et Michael Kozak. Or le premier réapparut au Kosovo en janvier 1999 lorsque, en tant que chef de la Mission de vérification, il supervisa la création du mensonge sur les « atrocités » qui servit de prétexte à la guerre. Michael Kozak, quant à lui, devint ambassadeur en Biélorussie où, en 2001, il monta l’opération « Blanche cigogne » destinée à renverser le président Alexandr Loukachenko. Dans un échange de lettres avec The Guardian, en 2001, il eut le front de reconnaître qu’il faisait en Biélorussie exactement ce qu’il avait fait au Nicaragua et au Panama, c’est-à-dire « promouvoir la démocratie » [16]
La technique moderne du coup d’Etat se présente essentiellement sous trois formes : ONG, contrôle des médias et agents secrets. Leurs activités sont interchangeables, si bien que je ne les traiterai pas séparément.
Serbie, 2000
Le renversement de Slobodan Milosevic ne fut manifestement pas la première fois où l’Occident utilisait des influences clandestines pour provoquer un changement de régime. Le renversement de Sali Berisha en Albanie en 1997 et celui de Vladimir Meciar en Slovaquie en 1998 ont été fortement influencés par l’Occident et dans le cas de Berisha, un soulèvement extrêmement violent fut présenté comme un exemple bienvenu de prise du pouvoir spontanée par le peuple. J’ai personnellement observé comment la communauté internationale et en particulier l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe), falsifièrent les résultats de leur contrôle des élections afin d’assurer le changement politique. Cependant le renversement de Milosevic à Belgrade, le 5 octobre 2000, est important parce qu’il s’agissait d’une personnalité très connue et que la « révolution » qui l’a destitué impliquait un usage très ostentatoire du « pouvoir populaire ». Le contexte du putsch contre Milosevic a été brillamment décrit par Tim Marshall, journaliste à Sky TV. Ce qu’il montre est valable parce qu’il approuve les événements qu’il évoque et qu’il se vante de ses nombreux contacts avec les services secrets, en particulier ceux de Grande-Bretagne et des États-Unis.
À tout instant, Marshall semble savoir qui sont les principaux agents secrets. Son compte rendu est plein de références à « un agent du MI6 de Pristina », à des « sources des services secrets yougoslaves », à « un homme de la CIA qui a aidé à préparer le coup d’État », à un agent des services secrets de la marine américaine », etc. Il cite des rapports secrets des renseignements serbes, il sait qui est le chef d’état-major du ministre britannique de la Défense qui mit au point la stratégie du renversement de Milosevic. Il sait que les conversations téléphoniques du ministre des Affaires étrangères britannique sont écoutées. Il sait qui sont les agents des services secrets russes qui accompagnent Evgueni Primakov, le Premier ministre russe, à Belgrade pendant les bombardements de l’OTAN. Il sait dans quelles chambres de l’ambassade de Grande-Bretagne il y a des micros et où sont les espions yougoslaves qui écoutent les conversations des diplomates. Il sait qu’un membre de la Commission des relations internationales de la Chambre des représentants états-unienne est en réalité un agent des services secrets de la marine. Il semble savoir que des décisions des services secrets sont souvent prises sans l’accord complet des ministres. Il décrit comment la CIA a escorté la délégation de l’Armée de libération du Kosovo jusqu’à Paris pour les entretiens de Rambouillet avant la guerre où l’OTAN lança à la Yougoslavie un ultimatum dont elle savait qu’il ne pouvait pas ne pas être rejeté. Il fait allusion à un « journaliste britannique » qui a servi d’intermédiaire entre Londres et Belgrade pour des négociations secrètes à un haut niveau extrêmement importantes où les participants cherchèrent à se trahir les uns les autres au moment où le pouvoir de Milosevic s’effondrait. (Je le soupçonne de parler ici de lui-même.)
Un des thèmes qui traversent son livre sans qu’il le veuille est que la frontière entre les journalistes et les barbouzes est ténue. Au début du livre, Marshall parle en passant des « liens inévitables entre les agents, les journalistes et les politiques », disant qu’ils « travaillent tous dans le même domaine ». Il continue sur le ton de la plaisanterie en disant que c’est une « association de barbouzes, de journaleux et de politicards, plus le peuple » qui a causé la chute de Milosevic. Il adhère au mythe de la participation du « peuple » mais le reste de son livre montre qu’en réalité le renversement du président yougoslave n’a pu avoir lieu que grâce à des stratégies politiques conçues à Londres et à Washington.
Avant tout, Marshall fait bien comprendre qu’en 1998, le département d’État et les services de renseignements décidèrent d’utiliser l’Armée de libération du Kosovo (ALK) pour se débarrasser de Milosevic. Il cite une source selon laquelle « le projet des États-Unis était clair : lorsque le moment serait venu, ils utiliseraient l’ALK pour apporter la solution au problème politique », le « problème » étant la survie politique de Milosevic. Cela voulait dire qu’on soutenait le sécessionnisme terroriste de l’ALK pour mener ensuite une guerre contre la Yougoslavie à ses côtés. Marshall cite Karl Kirk, un agent des services secrets de la marine états-unienne : « Finalement, nous avons engagé une vaste opération à la fois ouverte et secrète contre Milosevic ». La partie secrète de l’opération consistait non seulement à étoffer les différentes missions d’observation envoyées au Kosovo d’agents des services secrets britanniques et états-uniens, mais également – et c’était crucial – d’apporter une aide militaire, technique, financière, logistique et politique à l’ALK qui faisait du trafic de drogue et d’êtres humains et assassinait des civils. »
La stratégie commença à la fin de 1998 lorsqu’une « importante mission de la CIA fut mise en œuvre au Kosovo ». Le président Milosevic avait autorisé la mission d’observation diplomatique du Kosovo à entrer dans la province pour y contrôler la situation. Ce groupe fut immédiatement étoffé d’agents secrets et de forces spéciales britanniques et états-uniens, d’hommes de la CIA et des services secrets de la marine US, de membres du Special Air Service britannique et du 14th Intelligence, corps de l’armée britannique qui opère aux côtés du SAS pour effectuer ce qu’on appelle de la « deep surveillance ». Le but immédiat de l’opération était d’effectuer de l’« intelligence preparation of battlefield » [méthode d’analyse du terrain susceptible de devenir un champ de bataille], version moderne de ce que le duc de Wellington avait l’habitude de faire, c’est-à-dire de parcourir le champ de bataille de long en large pour se rendre compte de la configuration du terrain avant d’attaquer l’ennemi. Ainsi, comme l’écrit Marshall, « officiellement la KDOM [Mission diplomatique d’observation au Kosovo] était dirigée par l’OSCE en Europe et officieusement par la CIA. C’était un front de la CIA. » En fait, la plupart de ses membres travaillaient pour un autre front de la CIA, la DynCorp, compagnie basée en Virginie qui emploie, selon Marshall surtout des « membres des unités d’élite de l’armée américaine ou de la CIA ». On utilisa la KDOM, qui devint plus tard la Mission de vérification au Kosovo pour faire de l’espionnage. Au lieu d’effectuer les tâches de contrôle qui leur étaient assignées, les membres de la Mission utilisaient leurs GPS pour localiser et identifier les cibles que l’OTAN bombarderait plus tard. On a du mal à comprendre comment les Yougoslaves ont pu permettre que 2000 agents des services secrets parfaitement entraînés parcourent leur territoire, d’autant que, comme le montre Marshall, ils savaient très bien ce qui se passait.
Le chef de la Mission de vérification au Kosovo était William Walker, l’homme qui avait eu pour mission d’évincer Noriega du pouvoir au Panama et qui avait été ambassadeur des États-Unis au Salvador dont le gouvernement, soutenu par Washington, entretenait des escadrons de la mort. Walker « découvrit » le « massacre » de Racak en janvier 1999, événement utilisé comme prétexte pour engager le processus conduisant aux bombardements qui commencèrent le 24 mars. De nombreux témoignages laissent penser que Racak était une mise en scène et que les corps trouvés là étaient ceux de combattants de l’ALK et non de civils, comme on l’a prétendu. Ce qui est certain, c’est que le rôle de Walker était si important que la route nationale du Kosovo qui mène à Racak a reçu son nom. Marshall écrit que la date de la guerre – printemps 1999 – n’a pas seulement été décidée à la fin de décembre 1998, mais qu’elle a été communiquée à ce moment-là à l’ALK. Cela signifie que lorsque le « massacre » a eu lieu et que Madeleine Albright déclara que le printemps était précoce cette année-là, elle se comportait comme Goebbels qui, apprenant la nouvelle de l’incendie du Reichstag en 1933, aurait dit : « Quoi, déjà ? »
De toute façon, Marshall écrit que lorsque la Mission fut retirée à la veille des bombardements de l’OTAN, les agents de la CIA qui en faisaient partie remirent tous leurs mobiles et leurs GPS à l’ALK. « Les Étaats-uniens entraînèrent l’ALK, l’équipèrent en partie et lui donnèrent virtuellement un territoire », écrit Marshall, même si lui, comme tous les autres reporters, a contribué à propager le mythe des atrocités commises systématiquement par les Serbes contre une population civile albanaise totalement passive.
La guerre commença, bien sûr, et la Yougoslavie fut violemment bombardée. Mais Milosevic restait au pouvoir. Aussi Londres et Washington se mirent à pratiquer ce que Marshall appelle une « guerre politique » pour le faire partir. Cela consistait à donner d’importantes sommes d’argent et d’apporter une aide technique, logistique et stratégique, y compris des armes, à différents groupes de l’« opposition démocratique » et à des ONG de Serbie. À ce moment-là, les États-uniens opéraient principalement par le biais de l’International Republican Institute [17] qui avait ouvert des bureaux en Hongrie dans le but de se débarrasser de Milosevic. Marshall explique qu’à l’une des réunions, « on était tombé d’accord sur le fait que les arguments idéologiques de démocratie, de droits civiques et d’approche humanitaire seraient beaucoup plus convaincants s’ils étaient accompagnés, le cas échéant, de beaucoup d’argent ». Cet argent, et beaucoup d’autres choses, d’ailleurs, entrèrent en Serbie par les valises diplomatiques, dans bien des cas celles de pays apparemment neutres comme la Suède qui, n’étant pas officiellement membre de l’OTAN, purent maintenir des ambassades complètes à Belgrade. Marshall ajoute que l’argent entra pendant des années. Des médias « indépendants », comme la station de radio B92 (éditeur de Marshall) étaient financés en grande partie par les États-Unis. Des organisations contrôlées par George Soros [18] jouèrent également un rôle essentiel, comme plus tard en Géorgie, en 2003–04. Les « démocrates » n’étaient en réalité rien d’autre que des agents étrangers, comme l’affirmait impassiblement le gouvernement yougoslave à l’époque.
Marshall explique aussi une chose qui est maintenant de notoriété publique, c’est-à-dire que ce sont également les États-uniens qui ont conçu la stratégie consistant à mettre en avant un candidat, Vojislav Kostunica, pour unifier l’opposition. Il présentait le principal atout d’être inconnu du grand public. Marshall montre que la stratégie impliquait aussi un coup d’État soigneusement préparé et qui eut lieu comme prévu. Il montre de manière très détaillée comment les principaux acteurs de ce qui fut présenté par les télévisions occidentales comme un soulèvement « populaire » spontané étaient en réalité une bande de voyous extrêmement violents et lourdement armés commandés par le maire de la ville de Cacak, Velimir Illic. C’est le convoi d’Illic long de 22 kilomètres qui transporta « des armes, des paras et une équipe de kickboxeurs » jusqu’au bâtiment du Parlement fédéral de Belgrade. Marshall admet que les événements du 5 octobre 2000 « ressemblaient plus à un coup d’État » qu’à la révolution populaire que présentaient si naïvement les médias du monde entier.
Géorgie, 2003
Bien des tactiques appliquées à Belgrade furent reprises ad nauseam en Géorgie en novembre 2003 pour renverser le président Edouard Chevardnadze [19]. Les mêmes allégations d’élections truquées furent faites et sans cesse répétées. (En Géorgie, il s’agissait d’élections législatives et en Yougoslavie de l’élection présidentielle.) Les médias occidentaux reprirent sans se poser de questions ces allégations qui avaient été formulées longtemps avant le scrutin. Une guerre de propagande fut déclenchée contre les deux présidents, dans le cas de Chevardnadze après une longue période où on l’avait encensé comme un grand démocrate réformateur. Les deux « révolutions » se produisirent après un similaire « assaut contre le Parlement » transmis en direct par les télévisions. Les deux transferts de pouvoirs furent négociés par le ministre russe des Affaires étrangères Igor Ivanov qui prit l’avion pour Belgrade puis pour Tbilissi afin d’organiser la chute des présidents en exercice. Et, last but not least, l’ambassadeur américain fut le même dans les deux cas : Richard Miles.
Cependant, la similitude la plus manifeste consiste dans l’utilisation d’un mouvement étudiant connu sous le nom d’Otpor (Résistance) en Serbie et Kmara (C’est assez !) en Géorgie [20]. Les deux mouvements avaient le même symbole, un poing serré noir sur blanc. Les gens d’Otpor entraînèrent ceux de Kmara et tous les deux furent soutenus par les États-Unis. Et les deux étaient manifestement structurés selon des principes communistes, associant l’apparence d’une structure diffuse de cellules autonomes et la réalité d’une discipline léniniste fortement centralisée.
Comme en Serbie, le rôle joué par les opérations secrètes et l’argent états-uniens fut révélé, mais seulement après les événements. Pendant ceux-ci, les télévisions ne cessèrent de parler du soulèvement du « peuple » contre Chevardnadze. Toutes les images contraires à ce mensonge optimiste furent occultées, comme le fait que la « marche sur Tbilissi » menée par Mikhail Saakachvili était partie de Gori, la ville natale de Staline, au pied de la statue de l’ancien tyran soviétique qui reste un héros pour beaucoup de Géorgiens. Les médias ne s’inquiétèrent pas lorsque le nouveau président, Saakachvili, fut confirmé dans ses fonctions par une élection qui le gratifia d’un score stalinien de 96 %.
Ukraine, 2004
Dans le cas de l’Ukraine, on observe la même combinaison d’activités des ONG financées par l’Occident, des médias et des services secr
(Message over 64 KB, truncated)