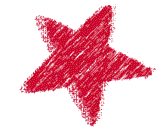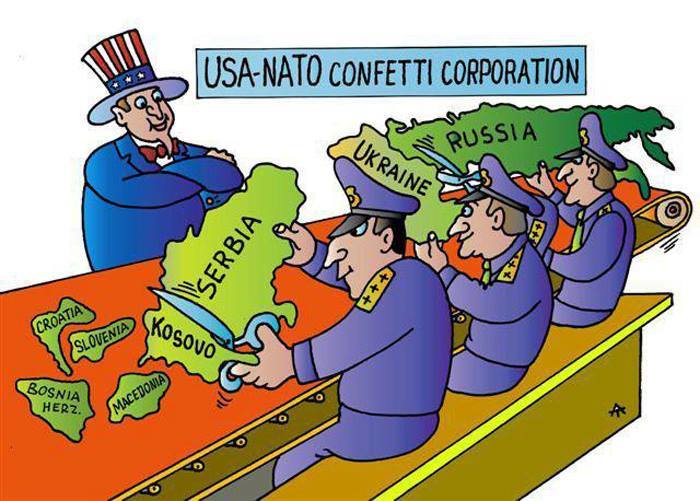Informazione
Propagande Cuba, Internet et Reporters sans frontières par Salim Lamrani* Reporters sans frontières, une ONG française financée par les États-Unis, poursuit sa campagne de dénigrement de Cuba. Cette fois l’accusation porte sur une censure d’Internet qui serait la preuve du caractère dictatorial du régime castriste. Or, les faits allégués sont de la pure imagination. Et, relève Salim Lamrani, s’il y a un problème d’accès à l’Internet à Cuba, ce n’est pas pour des causes politiques internes, mais à cause des coûts élevés, conséquence du blocus économique imposé par… les États-Unis. |
|
Décidément, Reporters sans frontières (RSF) n’en finit plus d’être obsédée par Cuba. Depuis plusieurs années, cette organisation parisienne mène une campagne de désinformation acharnée contre l’île des Caraïbes et son gouvernement. Dernièrement, elle a délibérément manipulé les propos du ministre cubain de l’Informatique et de la communication, Ramiro Valdés, lors de son intervention – le 11 février 2007 – à la 12ème conférence internationale sur l’Informatique de La Havane, qui a réuni plus de 600 délégués en provenance de 58 pays [1]. Manipulation des propos de Ramiro Valdés « Le ministre de la Communication, Ramiro Valdés, a déclaré, le 12 février 2007 [sic], qu’il considérait Internet comme un ‘outil d’extermination globale’ (Tool for global extermination) et qu’il fallait impérativement que cette ‘arme sauvage’ soit contrôlée », a déclaré RSF [2]. En réalité, le ministre cubain n’a jamais tenu de tels propos, comme cela est aisément vérifiable en consultant son discours. Il a dénoncé l’utilisation belliqueuse et répressive de la toile qu’en fait Washington pour y diffuser de la propagande en faveur des invasions de l’Afghanistan et de l’Irak et pour « augmenter le contrôle sur les gouvernements, les entreprises et les personnes, y compris le peuple nord-américain lui-même ». Valdés a souligné que « le Pentagone a fait part sans ménagement de sa décision d’incorporer un quatrième domaine d’opération aux corps spécialisés de la guerre conventionnelle. Aux classiques : Terre, Air, Mer, s’ajoute désormais le Cyberespace », conscient de l’importance grandissante de cet espace d’expression alternatif [3]. Au contraire, il a noté que « les technologies de l’Information et de la communication seront également au centre de cette volonté intégrationniste de la zone [Amérique] ». Valdés a stigmatisé l’utilisation malsaine d’Internet faite par les États-Unis et non pas l’outil d’information qu’est la toile. Il a insisté sur le fait qu’il était « indispensable de trouver des alliances stratégiques pour faire face aux tentatives hégémoniques dans ce nouveau champ de bataille » qui menacent « la souveraineté de nos peuples ». « Ces technologies se constituent en un des mécanismes d’extermination globale que [Washington] a inventé, mais malgré les risques connus qui en découlent, elles sont paradoxalement indispensables pour continuer d’avancer sur les voies du développement », a-t-il affirmé [4]. Valdés n’a pas jamais qualifié Internet d’« arme sauvage ». Il a argué de manière métaphorique que le « poulain sauvage des nouvelles technologies peut et doit être dominé » afin que les « communications informatiques soient mises au service de la paix et du développement » et non pas de la guerre, comme c’est le cas aux États-Unis [5]. En effet, le département de la Défense étasunien a annoncé le 2 novembre 2006 la création d’un Commando d’opérations des forces aériennes pour le Cyberespace pour renforcer la guerre électronique car, selon le lieutenant-général Robert Elder qui commande cette force, « il y a sans aucun doute beaucoup plus d’intérêt à utiliser le cyberespace comme un domaine de guerre [6] ». Les véritables déclarations du ministre cubain Ainsi, les manipulations de RSF sont nettement évidentes. L’organisation dirigée par Robert Ménard a attribué des propos à Valdés que ce dernier n’a jamais tenus. De plus, elle a soigneusement occulté les véritables déclarations, claires et sans ambiguïtés, du ministre cubain vis-à-vis d’Internet. En voici quelques-unes : « La Toile donne non seulement des possibilités d’expression aux secteurs ignorés par les grands médias, mais diffuse également des messages importants en faveur des aspects cruciaux pour l’humanité comme la paix, la protection de la planète et la justice, pour n’en citer que trois. De véritables communautés d’échange, de solidarité et de coopération se créent dans les champs de savoir humain les plus variés [7] ». Valdés a relevé qu’ « Internet pourrait se transformer en un véhicule pour une révolution culturelle et éducative qui promouvrait le savoir, qui promulguerait l’éducation, la culture, la coopération, la solidarité, et des valeurs éthiques et morales dont a besoin ce nouveau siècle, défendant les sentiments humains les plus nobles et rejetant les conduites inhumaines, égoïstes et individualistes imposés par le système capitaliste, avec les Etats-Unis en tête [8] ». Le « rapport » de RSF sur Internet à Cuba Pour ce qui est d’Internet à Cuba, « Reporters sans frontières rappelle que le retard de Cuba en matière d’Internet résulte avant tout de la volonté du gouvernement de contrôler la circulation de l’information sur son territoire. Avec moins de deux internautes pour 100 habitants, Cuba figure parmi les pays les plus en retard en matière d’Internet. Il est de loin le plus mal loti d’Amérique latine – le Costa Rica fait 13 fois mieux – et se situe au niveau de l’Ouganda ou du Sri Lanka [9] ». Ces affirmations de RSF ne découlent pas d’une étude minutieuse et comparative du développement d’Internet à travers le monde. Non, il s’agit simplement d’une allégation arbitraire qui ne se base sur aucune recherche et qui est complètement déconnectée de la réalité. Aucun organisme international n’a jamais avancé de tels chiffres. Encore une fois, RSF se contente de ressasser la propagande étasunienne à l’égard de l’Archipel des Caraïbes. Une réalité différente À Cuba, près de 2 millions d’enfants et d’adolescents ont accès chaque jour à Internet dans leurs établissements scolaires, tous équipés d’une salle informatique dotée de matériel de dernière génération. À Cuba, il existe 146 petites écoles dans les régions les plus reculées du pays qui sont fréquentées par un seul élève et toutes disposent d’un laboratoire informatique. À Cuba toujours, il existe plus de 600 clubs informatiques communautaires gratuits, fréquentés par plus d’un million de personnes, dans chacune des municipalités de la nation. Une question relevant du simple bon sens : si le gouvernement cubain souhaitait « contrôler la circulation de l’information sur son territoire », pourquoi dépenserait-il plusieurs millions de dollars pour universaliser l’accès à l’informatique et à Internet [10] ? RSF minimise soigneusement le principal frein au développement d’Internet à Cuba qui sont les sanctions économiques impitoyables que les États-Unis imposent à la population du pays depuis 1960. Cuba n’a pu se connecter à Internet qu’en 1996 car auparavant une clause du blocus économique l’empêchait d’avoir accès au réseau international contrôlé par les États-Unis. Mais l’accès cubain est toujours conditionné par la loi Torricelli de 1992 qui stipule que chaque mégabit acheté à une entreprise étasunienne doit recevoir préalablement l’approbation du département du Trésor. Tout contrevenant est sujet à des sanctions extrêmement dissuasives. De plus, il faut rappeler que plus de 80 % du trafic Internet passe par des serveurs étasuniens [11]. En outre, les États-Unis refusent à Cuba l’utilisation de leur câble sous-marin à fibre optique qui longe l’archipel. Ainsi, l’île est obligée de se connecter via satellite, ce qui ralentit considérablement la communication et qui en multiplie le prix par quatre. Pour une petite nation du Tiers-monde assiégée depuis près d’un demi-siècle, les effets ne sont pas négligeables. De la même manière, Cuba est obligé de se procurer les nouvelles technologies via des pays tiers à cause des sanctions économiques, ce qui en augmente considérablement leur prix. Il ne faut pas oublier non plus que les États-Unis produisent près de 60 % des logiciels au niveau mondial et que Microsoft contrôle le système opérationnel de 90 % des ordinateurs de la planète [12]. Toute cette réalité est délibérément censurée par RSF. Comment peut-il en être autrement d’une organisation qui est financé par Washington via l’officine écran de la CIA qu’est la National Endowment for Democracy (NED) [13] ? Peut-on s’attendre à autre chose d’une entité qui reçoit plusieurs dizaines de milliers de dollars de la part de l’extrême droite cubaine comme par exemple le Center for a Free Cuba, dirigé par Franck Calzón, lui-même ancien directeur de la Fondation nationale cubano-américaine, une organisation terroriste responsable de nombreux attentats contre Cuba [14] ? RSF n’a jamais dénoncé le fait que Washington utilise Internet pour infliger des sanctions pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison à ses propres citoyens qui commettent l’impardonnable crime de voyager à Cuba et qui achètent leur billet via le Réseau. Plusieurs agences de voyages qui proposaient des paquets touristiques à Cuba ont vu leur site Internet bloqué aux États-Unis. RSF ne s’est jamais émue d’une telle atteinte à la liberté d’expression et n’a jamais condamné les sanctions économiques contre Cuba [15]. L’autre « rapport objectif » de RSF sur Internet Le 19 octobre 2006, RSF a publié un « rapport » sur Internet à Cuba qui « démontre que les autorités brident délibérément l’accès à la Toile ». Là encore, l’organisation, qui prétend être objective et apolitique, n’explique pas pourquoi le seul pays sur lequel elle émet un « rapport » –qui brille par sa légèreté – est Cuba. Mais le plus intéressant est que ce rapport tendancieux, parsemé de contradictions et de contrevérités manifestes, reconnaît au final qu’il est possible à Cuba d’avoir « accès à pratiquement tous les sites d’informations, lemonde.fr, bbc.com, le Nuevo Herald (un quotidien de Miami [contrôlé par l’extrême droite cubaine]) et même les sites des dissidents du régime castriste [16] ». Le rapport ajoute : « Des tests effectués par Reporters sans frontières ont montré que la plupart des sites de l’opposition cubaine, ainsi que ceux des organisations internationales des droits de l’homme sont accessibles par le biais du service ‘international’. En Chine, des filtres par mots-clés sont installés sur le Réseau, ce qui rend par exemple impossible le téléchargement de pages contenant des mots-clés ‘subversifs’. L’organisation a pu vérifier, en testant une série de termes interdits à partir de cybercafés, qu’aucun système de ce type n’est installé à Cuba ». Cependant, RSF n’explique pas pourquoi mène-t-elle alors une campagne aussi obsessionnelle sur la supposée censure d’Internet à Cuba [17]. Le rapport est également jonché d’accusations grossières : « À Cuba, on peut être condamné à vingt ans de prison pour quelques articles ‘contre-révolutionnaires’ publiés sur des sites étrangers et à cinq ans simplement pour s’être connecté au net de manière illégale ». RSF multiplie les mensonges : « Les dissidents politiques et les journalistes indépendants ne sont en général pas autorisés à se rendre dans les cybercafés ». Toute personne s’étant déjà rendu dans un cybercafé à Cuba sait pertinemment que cela est faux. On n’y demande ni nom ni adresse, seulement le paiement du temps passé sur Internet [18]. RSF continue sur le même ton et admet que la Section d’intérêts nord-américains (SINA) à La Havane fournit une aide précieuse aux célébrissimes dissidents : « Nombre d’entre eux utilisent par conséquent la vingtaine d’ordinateurs mis à leur disposition par la SINA […]. Mais un seul passage dans les locaux de la diplomatie américaine suffit pour être considéré comme un ‘ennemi de la révolution’ ». Pour RSF, la « diplomatie américaine » n’accueille pas les « dissidents » pour subvertir l’ordre établi et renverser le gouvernement. Elle leur tend simplement une main désintéressée et altruiste. Washington défend naturellement la démocratie. D’ailleurs, ses activités à travers le monde et l’engagement de Washington en Afghanistan et en Irak en sont des preuves irréfutables [19]. Dans n’importe quel pays du monde, le fait de fréquenter assidûment les diplomates d’une puissance étrangère — qui, dans ce cas précis, a publiquement déclaré le 10 juillet 2006 qu’elle se donnait 18 mois pour renverser le gouvernement en place — dans le but avoué de rompre l’ordre constitutionnel est synonyme de trahison et implique les sanctions les plus sévères qui soient. À Cuba, les légendaires « journalistes indépendants » se rendent chaque semaine aux bureaux de la SINA, mais ne rédigent pas d’articles sur les États-Unis. Les généreuses rétributions offertes par Washington sont leurs principales sources de motivation. Jusqu’à présent, les autorités cubaines se sont montrées plutôt indulgentes, hormis en mars 2003 [20]. À ce sujet, RSF continue de faire croire à l’opinion publique que les personnes détenues et condamnées à de lourdes peines en 2003, pour conspiration et pour avoir œuvré en tant qu’agents d’une puissance étrangère, sont des « journalistes indépendants ». Elle en dénombre 24 alors qu’en réalité un seul est réellement journaliste (Julio César Gálvez Rodríguez). De plus, ces personnes-là ont été condamnées uniquement pour avoir reçu un financement d’une nation ennemie, et en aucun cas pour avoir tenu des propos hétérodoxes au discours officiel. Pour s’en persuader, il suffit simplement de lire les virulentes déclarations contre le gouvernement révolutionnaire que les célèbres dissidents font chaque semaine à la presse internationale, sans qu’ils soient inquiétés par la justice [21]. « Les trous noirs du Web », selon RSF Le 16 novembre 2005, RSF rendait publique « sa liste des 15 ennemis d’Internet » dans laquelle figuraient l’Arabie saoudite, le Belarus, la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, l’Iran, la Libye, les Maldives, le Népal, l’Ouzbékistan, la Syrie, la Tunisie, le Turkménistan et le Vietnam. Bien évidemment, l’organisation de Robert Ménard n’indique aucunement les critères qu’elle a pris en compte pour sa sélection [22]. Un an plus tard, en 2006, une nouvelle liste de 13 pays était publiée dans laquelle ne faisait plus partie la Libye. Le rapport de 2005 était pourtant accablant : « Malheureusement, dans un pays qui ne tolère aucune presse indépendante, il eut été étonnant que le Web se développe sans entraves. Ainsi, les sites de dissidents libyens en exil sont systématiquement bloqués par les filtres mis en place par le pouvoir. Plus grave, les autorités s’attaquent désormais durement aux internautes dissidents [23] ». Le rapport 2006 est aux antipodes de celui de 2005. « Suite à une mission dans le pays, Reporters sans frontières a pu constater que l’Internet libyen n’était plus censuré », affirme l’organisation, sans aucune autre explication et sans publier aucun rapport. Que s’est-il passé en un an pour RSF change radicalement d’avis à propos de la Libye ? Mouammar Kadhafi a-t-il changé de politique intérieure ? Ou bien a-t-il tout simplement normalisé ses relations avec Washington et fait désormais partie des alliés de l’administration Bush ? Serait-ce la raison pour laquelle il peut désormais recevoir des bonnes notes de la part de RSF [24] ? Ainsi, le classement de RSF n’est rien d’autre qu’une farce. Le travail de l’organisation parisienne n’a rien à voir avec la liberté de la presse mais est avant tout une guerre idéologique au service de ses bailleurs que sont les États-Unis et ses satellites comme Taiwan. Le rapport de OpenNet Iniciative La fondation OpenNet Initiative, parrainée par les très conservatrices universités de Harvard, Cambridge, Oxford et Toronto, fonctionne comme un observatoire de la liberté d’expression sur Internet. Selon cette entité, 13 % des internautes du monde ne sont pas libres de naviguer sur le Web, soit 146 millions de personnes. OpenNet Initiative a établi une liste de 9 pays qui limitent l’accès à Internet et qui répriment les internautes. Il s’agit de la Chine, la Syrie, l’Arabie saoudite, la Birmanie, le Vietnam, l’Iran, l’Ouzbékistan, la Tunisie et le Yémen. Cuba ne figure pas sur cette liste [25]. Ensuite, la fondation établit une liste de 22 autres nations où les degrés de contrôle existent parmi lesquels se trouvent le Royaume-Uni à la 16ème position, la France à la 17ème, le Canada à la 18ème, les États-Unis à la 19ème et Cuba au 20ème rang seulement [26]. Plus intéressant encore, OpenNet Initiative détaille la nature des obstacles imposés à l’accès à Internet. Par exemple, le Royaume-Uni filtre certains contenus pour, selon le gouvernement britannique, éviter la diffusion de la pornographie infantile. En ce qui concerne la France, l’administration filtre « sans décision judiciaire » les contenus de sites d’extrême droite. Pour le Canada, le contrôle et les filtres existent dans les collèges et les bibliothèques publiques. Enfin, pour Cuba, c’est uniquement le coût de la connexion pour les particuliers qui est « prohibitif [27] ». La fondation n’évoque en aucun cas un contrôle ou des filtres imposés par l’État cubain. Elle souligne que « les Cubains ont amplement accès à l’intranet national en échange. Des tests préliminaires indiquent que très peu de sites Web sont bloqués ». Le seul site Internet bloqué est, selon OpenNet Initiative, celui de l’organisation terroriste de Floride Brothers to the Rescue. Ainsi, le principal responsable de la restriction de l’accès à Internet à Cuba n’est rien d’autre que… le gouvernement des États-Unis qui impose des sanctions au pays et empêche le développement technologique de la nation. [28]. RSF continue sa guerre de propagande contre Cuba et tente de tromper l’opinion publique sur la réalité de cette île assiégée. Elle reste ainsi fidèle à l’agenda belliqueux de l’administration Bush. |
|
Sur le même sujet voir : |
« Reporters sans scrupules », par Michel Sitbon (20 septembre 1995) |
« Venezuela : médias au-dessus de tout soupçon », par Thierry Deronne et Benjamin Durand (18 juin 2004) |
« Quand Reporters Sans Frontières couvre la CIA », par Thierry Meyssan (25 avril 2005) |
« Les mensonges de Reporters sans frontières », par Salim Lamrani (2 septembre 2005) |
« Le silence de Reporters Sans Frontières sur le journaliste torturé à Guantanamo », par Salim Lamrani (30 janvier 2006) |
« Le financement de Reporters sans frontières par la NED/CIA », par Diana Barahona et Jeb Sprague (7 août 2006). |
« Droit de réponse de Reporters sans frontières » (12 septembre 2006). |
« Reporters sans frontières et ses contradictions », par Salim Lamrani (27 septembre 2006). |
« La guerre de désinformation de Reporters sans frontières contre le Venezuela », par Salim Lamrani (6 février 2007). Dans la librairie du Réseau Voltaire |
Pour en savoir plus, lire Le Dossier Robert Ménard. Pourquoi Reporters sans frontières s’acharne sur Cuba par Jean-Guy Allard et Marie-Dominique Bertuccioli, Lanctôt éditeur (Québec), 12 euros. [1] Reporters sans frontières, « Reporters sans frontières réagit aux déclarations du ministre de la Communication à propos d’Internet », 13 février 2007. http://www.rsf.org/article.php3 ?id_article=20998 (site consulté le 13 février 2007). [2] Ibid [3] Ramiro Valdés, « Discurso pronunciado por el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, Ministro de la Informática y las Comunicaciones en el Acto Inaugural de la XII Convención y Expo Internacional, Informática 2007 », Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, 11 février 2007. http://www.cubaminrex.cu/Sociedad_Informacion/2007/DiscursoRamiro.htm (site consulté le 14 février 2007). [4] Ibid [5] Ibid [6] Sara Wood, « New Air Force Command to Fight in Cyberspace », American Forces Press Service,U.S. Department of Defense, 3 novembre 2006. http://www.defenselink.mil/News/NewsArticle.aspx ?id=2014 (site consulté le 27 février 2007). [7] Ramiro Valdés, op. cit [8] </ |
http://www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/6937/1/42
Il ritorno di Josip Broz
A TUTTE LE REALTA' TERRITORIALI: INDICATECI EVENTUALI MOBILITAZIONI PER IL PROSSIMO 27 MARZO. PROVVEDEREMO A DIFFONDERLE E FARLE CONOSCERE ATTRAVERSO LA NOSTRA MAILING LIST ED IL NOSTRO SITO
la Rete nazionale Disarmiamoli
Bologna, 27 marzo
Presidio contro la guerra
DISARMIAMOLI! di Bologna, in concomitanza con il voto sulla missione di guerra in Afghanistan al senato della Repubblica, invita il movimento no-war a partecipare al presidio di martedi 27 alle ore 17 presso piazza Re Enzo a Bologna per dire NO ai crediti di guerra.
Dopo la manifestazione nazionale del 17 marzo, che ha dimostrato la capacità del movimento no-war di riaffermare il suo essere senza se e senza ma contro la guerra, in diverse città italiane si manifestara il 27 marzo per riaffermare la voglia di pace del popolo italiano e per chiedere ai senatori/trici, eletti/e con i voti del popolo no-war di votare contro il decreto che finanzia le missioni di guerra.
NON VOTATE LA GUERRA VIA LE TRUPPE ORA
Per il ritiro immediato delle truppe dall'Afghanistan e dagli altri fronti di guerra
Libertà per il popolo afgano, libertà per Adjmal e Hanefi
Chiusura della basi Usa e Nato
No alle spese militari
DISARMIAMOLI! Bologna
http://www.gaullisme.fr/breve_200307.htm
Objectif France Magazine, 20 mars 2007
Retour honteux de la France dans l’OTAN
- Paul-Marie de La Gorce (décédé le 1er décembre 2004)
Annoncée en pleine grève, le 5 décembre 1995, la réintégration de la France au sein du conseil des ministres et du comité militaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord est passée quasiment inaperçue. Or cette décision tourne la page ouverte en 1966 par le général de Gaulle avec le retrait de l’organisation militaire intégrée de l’Alliance. Aboutissement d’un rapprochement progressif engagé dès les années 70, cet acte politique majeur s’appuie sur des arguments fallacieux.
A peine commentée, pratiquement négligée par les milieux politiques, la décision du gouvernement français de se faire à nouveau représenter en permanence dans plusieurs des organismes militaires de l’Alliance atlantique n’est pas passée inaperçue dans les autres pays occidentaux. Elle y a été saluée comme un retournement majeur de la politique française. En annonçant cette réintégration au sein du conseil des ministres de la défense et du comité militaire de l’OTAN, Paris a précisé qu’il n’y aurait toujours aucune participation à des organismes « intégrés » et qu’en particulier aucune force ne ferait retour dans le système militaire « intégré » de l’Alliance. Cette distinction n’est pas sans importance. Quand, en 1966, le général de Gaulle ayant décidé que la France quittait l’organisation militaire de l’Alliance en raison même de l’intégration qui la caractérisait, il lui fut demandé quelle en était sa définition, il répondit, par écrit, que l’intégration se définissait par la subordination et l’automaticité.
C’est dire que le gouvernement actuel n’a pas voulu ou pas osé franchir un certain seuil : les forces françaises ne seront toujours pas « subordonnées » au commandement de l’OTAN, ni « automatiquement » engagées par les décisions qu’il prendrait et auxquelles la France ne souscrirait pas. Encore faut-il apporter une restriction : le corps européen dont font partie des unités françaises serait soumis au commandement atlantique en cas d’hostilités _ on peut néanmoins admettre qu’il s’agit là d’une hypothèse extrême et, dans l’état actuel des choses, sans grande vraisemblance. Le retour de représentants français dans les organismes militaires atlantiques du plus haut niveau constitue pourtant un tournant politique majeur dont il faut essayer de comprendre le sens, car plusieurs interprétations en ont été données officiellement ou officieusement. Tantôt, on a fait remarquer qu’il ne s’agissait que d’une étape supplémentaire, dans la suite de toutes celles qui ont progressivement comblé le fossé creusé nettement et clairement en 1966 par la décision de se retirer de toutes les instances militaires de l’OTAN. Tantôt, on l’a présentée comme résultant inévitablement de la participation d’un important contingent français aux forces internationales déployées en Bosnie, et qui dépendront du commandement atlantique : dès lors, la présence de la France à ses instances militaires les plus élevées s’imposerait. Et plus souvent, enfin, on a suggéré que l’objectif était, par des relations plus étroites et plus complètes avec tous les organismes de l’Alliance, de pouvoir contribuer à sa réforme et, en particulier, à celle de son système de défense et de ses structures militaires. Il faut faire la part de ces diverses motivations. Rattacher cette décision seulement à une série de rapprochements entre la France et l’organisation militaire atlantique serait la banaliser abusivement et en réduire la portée. L’accord Ailleret-Lemnitzer, conclu en 1967, et dont le texte est très succinct et de caractère très général, n’a prévu que des contacts d’état-major, évidemment indispensables au cas où l’Europe occidentale aurait été le théâtre d’un conflit dans lequel la France aurait choisi de s’impliquer (1).
L’accord Valentin-Ferber, du 3 juillet 1974, complétait le précédent : le corps d’armée français en Allemagne étant très étroitement rattaché à l’ensemble de la première armée dont le commandement était en territoire français, c’est bien celle-ci - dont le général Valentin était le chef - qui serait impliquée par l’éventuelle coordination entre états-majors français et atlantique (2). Conclu quatre ans plus tard, l’accord Biard-Schulze porta sur les procédures nécessaires à cet égard, bien qu’il fût précisé qu’il n’avait qu’une « portée générale » (3). Un rapprochement progressif QUANT aux rapports entre forces aériennes et défenses antiaériennes françaises et alliées, les arrangements conclus, depuis l’accord Fourquet-Goodpaster de 1970 jusqu’aux accords Fatac-Aafce (Force aérienne tactique française et forces aériennes alliées du centre-Europe), ils avaient un caractère technique et pratique imposé par la nature même de l’action aérienne, mais ne comportaient évidemment aucun degré d’intégration. Il en allait de même du système de détection Nadge, dont le général de Gaulle avait décidé que la France continuerait de faire partie et qui, contrairement à ce qui est parfois écrit, est une organisation commune et non pas intégrée (4). A partir du début des années 80, des gestes nouveaux sont venus préciser les hypothèses d’actions conjointes entre forces françaises et atlantiques, au point qu’on fit étalage de l’amélioration substantielle et systématique des rapports entre la France et l’OTAN. Ainsi de la décision d’envisager l’engagement du nouveau troisième corps d’armée, créé à Lille, au-delà de la ligne Rotterdam-Dortmund-Munich, admise auparavant comme limite extrême d’éventuels mouvements français (5). Ainsi des hypothèses d’emploi imaginées pour la Force d’action rapide (FAR), encore que son engagement sur les zones avancées du théâtre européen eût été plus démonstrative que stratégique _ chacun savait qu’elle était par-dessus tout destinée à renforcer les moyens d’action extérieure de la France. Tout fut fait, cependant, pour mettre en valeur le rapprochement progressif entre le système français de défense et l’organisation militaire atlantique, comme en 1986 avec la participation d’une division entière à l’exercice « Frankischer Schild » (depuis 1966, jamais plus d’un régiment n’avait pris part à de telles manœuvres) et celle, plus ample encore, de 20 000 hommes à l’exercice « Moineau hardi » de 1987.
Le gouvernement est allé jusqu’à annoncer publiquement que la France n’emploierait pas ses armes nucléaires préstratégiques sans en informer auparavant le gouvernement allemand _ nul n’ignorait qu’il en irait ainsi puisque, même conçues comme « ultime avertissement » à l’adversaire et comme prélude à l’emploi de l’armement stratégique, ces engins auraient un certain effet sur le terrain. Donnée à la suite d’entretiens entre MM. François Mitterrand et Helmut Kohl, cette précision pouvait, du reste, paraître paradoxale : la portée conférée finalement aux missiles préstratégiques Hadès et surtout l’emploi éventuel de la composante aérienne préstratégique laissaient en effet supposer que le territoire allemand ne serait pas forcément le théâtre des frappes françaises. A l’arrière-plan des discours officiels et des commentaires officieux sur les liens progressivement rétablis entre la France et le système militaire de l’OTAN, et des démonstrations plus ou moins tapageuses destinées à les faire valoir, les réalités stratégiques demeuraient. M. Mitterrand lui-même insistait sur son refus d’adhérer à toute forme de « riposte graduée », c’est-à-dire à la stratégie de l’OTAN, et, à l’inverse, sur le maintien de la stratégie française de dissuasion nucléaire et sur ses principes essentiels. En baptisant « préstratégiques » les armes nucléaires tactiques françaises, dès le début de son premier septennat, il marquait son refus de glisser sur une pente qui aurait pu conduire au rapprochement avec les concepts d’emploi des armes nucléaires tactiques américaines en Europe. Et, au début du second septennat, la réorganisation des armées françaises, baptisée « Armées 2000 », allait dans le même sens : elle les répartissait entre les trois façades méditerranéenne, atlantique et continentale, en réduisait les effectifs tout en supprimant le troisième corps d’armée (6). En définitive, malgré l’ostensible adhésion de la France au bloc occidental et l’inflexion majeure de sa politique étrangère en faveur de relations très étroites avec les Etats-Unis, rien n’empêchait que la stratégie de Paris et celle de l’OTAN demeurent non seulement différentes, mais en réalité incompatibles. Avec le rappel des principes de la dissuasion française, alors même que l’organisation militaire atlantique adoptait en 1988 la doctrine Rogers de « Follow-on Forces Attack », inspirée par le concept d’« Airland Battle » (7), on doit même constater qu’elles se tournaient le dos. La décision de retour dans les organismes du plus haut niveau du système militaire atlantique n’était donc en aucune manière une conséquence de gestes précédents. A strictement parler, elle n’était pas non plus le résultat de la participation d’unités aux forces destinées à l’application du traité de paix sur la Bosnie, signé à Paris le 14 décembre 1995. La présence militaire française dans l’ex-Yougoslavie procédait à l’origine de la part prise aux missions que les Nations unies s’étaient données ; le commandement français sur place s’insérait, de ce fait, dans celui de la Forpronu. Un changement capital est survenu quand il a été décidé que l’OTAN se chargerait de quelques-unes de ces missions, en particulier pour l’application de l’embargo sur les ventes d’armes aux belligérants et, de façon plus significative encore, pour les raids aériens. En décidant que l’OTAN serait désormais leur « bras armé », les Nations unies donnaient à cette organisation un rôle nouveau et se dessaisissaient d’une partie de leurs prérogatives et de leurs pouvoirs au profit d’un organisme placé sous l’égide des Etats-Unis. Elles renonçaient à mettre en vigueur les articles de la Charte qui prévoient que, pour ses actions militaires, elle se doterait de son propre état-major et de ses propres commandements. A cet égard, l’affaire yougoslave aura conféré à l’OTAN un rôle sans précédent, bien au-delà de l’aire géographique couverte par le traité qui l’a fondée. La France n’a pas pour autant décidé de réintégrer ses organismes militaires dirigeants, et rien ne l’obligeait à le faire. Tout au plus peut-on estimer que l’affaire yougoslave a fonctionné ici comme un engrenage. Cette participation aux instances dirigeantes de l’organisation militaire atlantique a-t-elle, cependant, pour but et aura-t-elle pour effet de la réformer ? On le suggère officieusement : il serait plus facile de s’y faire entendre et la réflexion sur l’avenir de l’alliance dans l’après-guerre froide pourrait ainsi progresser. L’expérience, toutefois, ne justifie pas cet optimisme. Et l’argument avait d’ailleurs été mis au service du maintien de la France dans l’OTAN au début des années 60, lorsque le général de Gaulle en contestait ouvertement les principes. Mais aucune réforme ne fut entreprise, les Etats-Unis y veillaient, avec l’approbation de leurs alliés. En irait-il autrement désormais, la guerre froide ne pouvant plus être invoquée pour justifier les rigidités anciennes ? N’était-il pas temps, notamment, de restituer aux Etats européens plus de responsabilités, donc de réduire le degré d’intégration des forces de l’OTAN grâce auquel le commandement américain y exerce une prépondérance absolue ? C’est, au contraire, un surcroît d’intégration que manifeste la création d’une Force de réaction rapide de l’OTAN, où le niveau d’intégration descend plus bas que dans n’importe quel autre système de forces _ au niveau du régiment _ et dont le commandement, confié à un Britannique, est entièrement dépendant du commandement suprême américain en Europe (Saceur). Autre évolution significative : celle de la zone de compétence de l’Alliance atlantique et, par conséquent, de son organisation militaire. Plusieurs pays européens, et en premier lieu la France, ont toujours été hostiles à son extension. Ils ne souhaitaient pas que, dans d’autres régions du monde et donc d’autres zones de conflits, fonctionne un système à l’expérience contrôlé et dirigé en permanence par Washington. L’inverse se produisit. Lors de la crise du Golfe, quand la Turquie, membre de l’OTAN, invoqua un danger _ imaginaire _ d’agression irakienne pour réclamer une présence alliée sur son territoire, sous le couvert de l’organisation atlantique, avec en prime une participation allemande, l’Alliance se trouvait, en tant que telle, impliquée dans les marges du conflit. Puis on vit, par le biais des accords conclus entre Etats membres de l’Alliance et de l’ex-pacte de Varsovie, les problèmes de l’Europe centrale et orientale entrer dans le champ des compétences de l’OTAN, y compris en matière de sécurité. L’étape décisive intervint quand, comme on l’a vu, les Nations unies firent de l’OTAN leur « bras armé » dans l’affaire yougoslave : l’organisation atlantique prit en main d’abord la gestion militaire de la crise, puis le contrôle de la mise en application des accords de paix. C’était la reconnaissance officielle et générale du rôle de l’OTAN au-delà de l’aire géographique couverte par le traité qui l’a fondée _ exactement ce que la politique française avait toujours voulu empêcher ! Il faut donc le reconnaître, la décision de rétablir une participation française permanente aux organismes dirigeants du système militaire atlantique a été prise pour d’autres raisons. Les tentatives de ces dernières années en vue de faire progresser l’idée d’un système européen de défense ont échoué. Conformément à la tradition de sa diplomatie depuis sa naissance, la République fédérale allemande a naturellement montré envers les propositions françaises une amabilité calculée, dont on a vu à la fois l’effet et les limites avec son adhésion au corps européen. Les contributions d’autres pays avaient le même caractère symbolique. Depuis la conférence atlantique réunie en décembre 1991, on sait que les partenaires européens de la France ne veulent absolument pas d’un système de défense indépendant de l’OTAN qui, par conséquent, risquerait d’éloigner, si peu que ce soit, les Etats-Unis du théâtre européen. Au contraire, leur conviction est qu’ils ont intérêt _ sur les plans politique, stratégique et financier _ à les y maintenir en permanence, quitte à satisfaire à leurs conditions. Leur état d’esprit n’ayant apparemment pas changé, la diplomatie française se heurterait aux mêmes obstacles et aux mêmes réticences si elle songeait faire prévaloir ses conceptions dans les organismes dirigeants de l’organisation militaire atlantique qu’elle réintègre. Du reste, le veut-elle ? Quand la fin de la guerre froide a fait disparaître la justification historique donnée au système atlantique, très peu de voix se sont élevées en France pour le mettre en cause _ celles de l’ancien premier ministre, M. Pierre Messmer (8), de l’ancien secrétaire général du ministère des affaires étrangères, M. Gilbert Pérol (9), de très rares hommes politiques ou observateurs. Et le moins qu’on puisse dire est qu’elles n’ont pas été entendues.
(1) Michael M. Harrison, The Reluctant Ally : France and Atl antic Security, John Hopkins University Press Baltimore, 1988. Général Valentin, « La dissuasion et les armements classiques », dans L’Aventure de la Bombe, de Gaulle et la dissuasion nucléaire, Plon, Paris, 1985.
(2) Général Valentin, « La mission des forces françaises en centre-Europe et la coopération franco-britannique », dans Pour une nouvelle entente cordiale, Masson, 1988. Lothar Rüehl, « La coopération franco-allemande à l’appui de l’Alliance et de l’Europe », Revue de l’OTAN (Bruxelles), décembre 1987.
(3) Frédéric Bozo, La France et l’OTAN, Masson, Paris, 1991.
(4) Général François Maurin, « L’originalité française et le Commandement », Défense nationale, Paris, juillet 1989.
(5) David S. Yost : « Franco-German Defense Corporation », dans The Bundeswehr and Western Security. McMillan Londres, 1990. Diego A. Ruiz Palmer, dans Nato-Warsaw Pact Force Mobilization, National Defense University Press, Washington, 1988.
(6) Diego A. Ruiz Palmer dans European Security Policy after the Revolutions of 1989, National Defense University Press, Washington, 1991. Général Henri Paris, Défense nationale, novembre 1989.
(7) Lire Paul-Marie de La Gorce, « Une remise en cause de la « riposte graduée », Le Monde diplomatique, octobre 1988.
(8) Défense nationale, novembre 1990.
(9) Gilbert Pérol, La Grandeur de la France, Albin Michel, Paris, 1992. * Auteur, notamment, de 39-45, Une guerre inconnue, Flammarion, Paris, 1995.